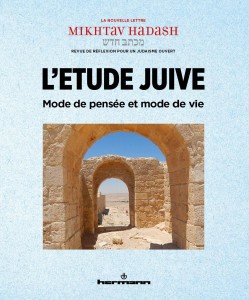Une énigme mystique
La clé principale pour comprendre le thème mystique du film est le sujet de travail du personnage principal qui est physicien, "le chat de Schrödinger".
Son frère, fou, cherche à résoudre des équations mathématiques de probabilité lui permettant de gagner aux jeux de hasard. S’il n’est pas parvenu à résoudre l’équation, remplissant un petit carnet de dessins délirants, il parvient néanmoins à dévaliser des casinos en gagnant à tous les coups.
Y a-t-il ou non un déterminisme ? Plusieurs niveaux de réalité peuvent-ils se superposer ? Peut-on être ici et ailleurs en même temps ? Peut-on être à la fois mort et vivant ? C’est la question que pose d’emblée le film avec le mystérieux personnage de départ, celui d’un dibouk supposé, mais saignant bel et bien lorsqu’il et transpercé d’un coup de couteau.
La physique quantique a apporté une révolution conceptuelle remettant en cause le principe du déterminisme qui supposait que chaque événement est déterminé par un principe de causalité. Pour la physique quantique, « Dieu joue aux dés… ». En fait il y aurait plusieurs niveaux de réalité, celle de l’infiniment petit obéissant à des règles différentes de celles de la physique normale.
Erwin Schrödinger est un physicien autrichien (1887 – 1961) anti nazie, il reçoit le prix Nobel de physique en 1933. Il est l’auteur de l’équation de Schrödinger portant sur des problèmes de physique quantique.
Erwin Schrödinger a imaginé une expérience dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte fermée avec un dispositif qui tue l’animal dès qu’il détecte la désintégration d’un atome d’un corps radioactif ; par exemple : un détecteur de radioactivité type Geiger, relié à un interrupteur provoquant la chute d’un marteau cassant une fiole de poison.
Si les probabilités indiquent qu’une désintégration a une chance sur deux d’avoir eu lieu au bout d’une minute, la mécanique quantique indique que, tant que l’observation n’est pas faite, l’atome est simultanément dans deux états (intact/désintégré). Or le mécanisme imaginé par Erwin Schrödinger lie l’état du chat (mort ou vivant) à l’état des particules radioactives, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états (l’état mort et l’état vivant), jusqu’à ce que l’ouverture de la boîte (l’observation) déclenche le choix entre les deux états. Du coup, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d’une minute.
La difficulté principale tient donc dans le fait que si l’on est généralement prêt à accepter ce genre de situation pour une particule, l’esprit refuse d’accepter une situation qui semble aussi peu naturelle appliquée à un sujet familier et banal comme un chat.
Il faut préciser que cette expérience n’a jamais été réalisée et qu’elle est en fait irréalisable.
Le but du « chat de Schrödinger » est surtout de marquer les esprits : si la théorie quantique autorise à un chat d’être à la fois mort et vivant, c’est ou bien qu’elle est erronée, ou bien qu’il va falloir reconsidérer tous les préjugés.
L’affirmation « Le chat est mort et vivant » est effectivement déroutante on peut préférer dire que le chat est dans un état où les catégorisations habituelles (ici la vie ou la mort) perdent leur sens.
Un certain nombre de théoriciens quantiques affirment que l’état de superposition ne peut être maintenu qu’en l’absence d’interactions avec l’environnement qui « déclenche » le choix entre les deux états (mort ou vivant). C’est la théorie de la décohérence. La rupture n’est pas provoquée par une action « consciente », que nous interprétons comme une « mesure », mais par des interactions physiques avec l’environnement, de sorte que la cohérence est rompue d’autant plus vite qu’il y a plus d’interactions. À l’échelle macroscopique, celui des milliards de milliards de particules, la rupture se produit donc pratiquement instantanément. Autrement dit, l’état de superposition ne peut être maintenu que pour des objets de très petite taille (quelques particules). La décohérence se produit indépendamment de la présence d’un observateur, ou même d’une mesure. Il n’y a donc pas de paradoxe : le chat se situe dans un état déterminé bien avant que la boîte ne soit ouverte.
La théorie des univers parallèles introduite par Hugh Everett stipule que la fonction d’onde décrit la réalité, et toute la réalité. Cette approche permet de décrire séparément les deux états simultanés et leur donne une double réalité qui semblait avoir disparu, dissoute dans le paradoxe (plus exactement deux réalités dans deux univers complètement parallèles - et sans doute incapables de communiquer l’un avec l’autre une fois totalement séparés). Cette théorie ne se prononce pas sur la question de savoir s’il y a duplication de la réalité (many-worlds) ou duplication au contraire des observateurs de cette même réalité (many-minds), puisqu’elles ne présentent pas de différence fonctionnelle.
Dans tous les cas, l’expérience de pensée du « chat de Schrödinger » et le paradoxe qui lui est associé ont aujourd’hui pris valeur de symboles centraux de la physique quantique.
Ce chat mort-vivant peut apparaître comme une expérience de pensée folle, mais c’est une bonne introduction à la complexité de la mécanique quantique. Si l’on ne peut mettre un chat dans deux états incompatibles, on peut en revanche le faire avec des particules simples comme les photons.
Le film des frères Coen, A serious Man, ne donne pas la solution à la question mystique qu’il soulève. Le personnage principal reste un homme sérieux qui cherche à comprendre la réalité telle qu’elle est à l’aide d’instruments mathématiques fiables. En même temps, sa réalité familiale lui échappe totalement. Il ne parvient absolument pas à maîtriser ce qui lui arrive, ni à en comprendre le sens. Il voudrait une réponse que personne n’est capable de lui apporter, ni sa propre science, la physique quantique, ni son entourage, ni les différents rabbins vers lesquels il se tourne.
Le personnage du vieux rabbin Marschak, le penseur kabbaliste qui ne quitte plus la cave de la synagogue, n’a qu’un seul message à donner sur le sens de la vie : « sois un bon garçon » prenant à son compte les paroles du groupe rock Jefferson Airplane qu’il a écouté attentivement.
Le film se termine sur l’annonce d’une mauvaise nouvelle qui tombe comme une sorte de punition divine d’une terrible sévérité pour avoir accepté de truquer les notes d’un élève, donc d’introduire de l’indéterminisme dans un système scolaire déterminé par les résultats réels de l’élève.
A l’horizon se lève une tempête menaçante, susceptible d’arracher le drapeau américain, représentant des valeurs de l’Amérique bien pensante, religieuse, terriblement conventionnelle. Cette tempête rappelle la présence divine dans le désert du Sinaï d’après le récit biblique. Loin d’être rassurante, elle est terriblement menaçante et susceptible de tout balayer sur son passage.
Les frères Coen signent ici un film difficile à comprendre mais qui illustre parfaitement toute la problématique religieuse et toute la difficulté de la condition humaine plongée dans un indéterminisme et un non sens le plus total.
En dehors, du questionnement mystique qu’il soulève, ce film présente une satire hilarante du judaïsme américain (ici celui de leur lieu de naissance, le Middle West) et une incisive critique sociale qui traverse toute l’œuvre cinématographique des deux frères dont le génie n’est plus à démontrer.
Yeshaya Dalsace
(Je tiens à remercier mon ami Gérard Touati pour m’avoir expliqué le principe du chat de Schrödinger.)
La musique
Paroles de la chanson du groupe des années 1960 Jefferson Airplane qui est au coeur du film :
When the truth is found to be lies
and all the joy within you dies
don’t you want somebody to love
don’t you need somebody to love
wouldn’t you love somebody to love
you better find somebody to love
When the garden flowers baby are dead yes
and your mind [, your mind] is [so] full of BREAD
don’t you want somebody to love
don’t you need somebody to love
wouldn’t you love somebody to love
you better find somebody to love
your eyes, I say your eyes may look like his [yeah]
but in your head baby I’m afraid you don’t know where it is
don’t you want somebody to love
don’t you need somebody to love
wouldn’t you love somebody to love
you better find somebody to love
tears are running [ahhh, they’re all] running down your breast
and your friends baby they treat you like a guest.
don’t you want somebody to love
don’t you need somebody to love
wouldn’t you love somebody to love
you better find somebody to love
Critique du Monde
Larry Gopnik, à part son nom, a de la chance. Il est américain, vit dans la quiétude pré-psychédélique des années 1960, a une famille sans histoire et habite une jolie banlieue résidentielle du Midwest où il enseigne la physique à l’université. Cet homme tranquille, modeste, sérieux donc, et qui ne demande rien à personne, allez savoir pourquoi les frères Coen ont décidé, dans A Serious Man, de lui pourrir la vie. Une évocation fidèle du film passe, de fait, par l’énumération des avanies qui, du jour au lendemain, se mettent à lui tomber sur le paletot comme les plaies d’Egypte.
D’abord, le cercle familial. Sa femme, Judith, brune vindicative, lui annonce un beau matin qu’elle le tient pour un cloporte, demande le divorce et le quitte pour Sy Ableman, dont elle est tombée amoureuse. Outre son insigne laideur et son obésité, Sy est un sentencieux imbécile, qui passe son temps à faire la leçon à Larry, nonobstant le fait qu’il lui pique sa femme. Le pauvre père ne trouve pas en ses enfants, deux monstres d’égoïsme pré-pubères, le moindre réconfort. Danny, le fils, est trop occupé à résoudre de lamentables embrouilles à l’école hébraïque. Sarah, la fille, ne songe qu’à se refaire le nez, en volant dans le portefeuille de son père. Cerise sur le gâteau familial : Arthur, le frère de Larry, chômeur chronique installé à demeure sur le canapé-lit du salon, quand il n’occupe pas la salle de bains pour drainer son kyste, inaugure à présent une carrière d’obsédé sexuel dans le Dakota.
Larry n’a même pas la ressource de se réfugier dans le travail. A l’université, il est calmement persécuté par un étudiant asiatique qui veut lui acheter son diplôme, et fait l’objet de lettres anonymes calomnieuses qui mettent en péril sa titularisation. Par ailleurs, son voisinage prend des allures dangereuses, entre le crypto-fasciste goy du pavillon mitoyen qui empiète sur sa pelouse, et le sex-appeal de Mme Samsky, quadragénaire de rêve et fumeuse de substances hallucinogènes, qui entrouvre sous les pieds de Larry le terrifiant abîme de la jouissance.
Sonné par ce déchaînement de malheurs, Larry n’aura d’autre recours que celui de se tourner vers les autorités traditionnelles de sa communauté : les rabbins . Ces visites, qui émaillent le film en montant progressivement dans la hiérarchie rabbinique, se révèlent désespérément infructueuses, et d’autant plus savoureuses que le protocole solennel qui les entoure révèle à chaque fois une coquille métaphysique totalement vide, soutenue par des paraboles abracadabrantes de parking ou de dentiste. C’est le fond de désespoir propre à ce film extrêmement drôle, qui inflige finalement à son héros une souffrance digne de sa seule passion : l’inconsistance.
A Serious Man livre ainsi, pour la première fois de manière aussi explicite, une clé essentielle de l’oeuvre des frères Coen : sa filiation avec la culture juive américaine. La spécificité de ladite culture étant précisément sa difficulté à se situer par rapport à une filiation. Pour deux raisons : l’acculturation rapide de la communauté juive aux Etats-Unis, et sa sourde culpabilité devant l’anéantissement qui frappa, à travers le judaïsme est-européen, son terreau originel, dans sa forme traditionnelle (le monde de l’étude religieuse) ou profane (la langue et la littérature yiddish, la lutte politique pour l’émancipation). Le judaïsme américain devient donc au XXe siècle l’incarnation exemplaire d’un judaïsme que la modernité dilue dans l’incertitude identitaire et la perte de ses repères. Existentiellement douloureuse et spirituellement angoissante, cette situation se révèle artistiquement fructueuse, notamment sur le plan d’un des derniers "traits juifs" pouvant prétendre à la pérennité : l’humour.
L’inspiration des frères Coen peut ainsi être rattachée à une tradition qui prendrait sa source chez les classiques européens de la littérature yiddish au début du XXe siècle (et au premier chef Cholem Aleikhem), se prolongerait au mitan de ce même siècle avec le répertoire des comiques se produisant dans les monts Catskill (lieu de villégiature des juifs new-yorkais, où débutèrent notamment Lenny Bruce et Jerry Lewis) avant de s’américaniser dans les années 1960 à travers les romanciers de l’Ecole de New York (Philip Roth, Bruce J. Friedman, Saul Bellow...), cette fois sous les auspices kafkaïens de l’absurde et du grotesque.
A Serious Man fournit quelques arguments à cette hypothèse, à commencer par le caractère autobiographique du film, situé dans une époque, une région et une sociologie dans lesquelles baigna la jeunesse des frères. Mais c’est aussi bien sa stupéfiante séquence d’ouverture, qui constitue un véritable coup de force dramaturgique : un apologue en noir et blanc, situé en Europe orientale, dialogué en yiddish, et inventé de toutes pièces par les cinéastes, à mi-chemin entre conte traditionnel et film gore. Entre ce prologue fantasmé et l’histoire du martyr Larry Gopnik, c’est bien un monde perdu qui gît dans le raccord. Quitte à renaître en dibbouk persécuteur, pour hanter l’un des plus grands films des frères Coen.
Critique de Jacques Mandelbaum parue dans Le Monde
Interview des Coen
Le 29 novembre 1954, Mme Coen, de Saint Louis Park (Minnesota) donnait le jour à son fils aîné, Joel. Le 21 septembre 1957, Joel faisait la connaissance de son petit frère Ethan. Un demi-siècle plus tard, devenus la créature (et le créateur) bicéphale la plus respectée du cinéma contemporain, les fils de Mme Coen reviennent sur les lieux de leur enfance.
Peut-on dire que A Serious Man est un film fait de mémoire ?
Ethan Coen : Oui, parce qu’il évoque un endroit et un moment sortis de nos souvenirs. Une communauté juive dans le Midwest comme celle dans laquelle nous avons grandi ; une année, 1967, qui correspond à notre enfance.
Joel Coen : Mais l’intrigue n’est pas faite de souvenirs.
La description que vous faites de la communauté est-elle tout à fait fidèle ?
E. C. : C’est très fidèle, la preuve c’est que le film provoque une puissante nostalgie...
J. C. : ... chez les gens qui ont vécu dans cette communauté à cette époque.
En général, les réalisateurs, qui exploitent un matériau autobiographique, le font dès leurs débuts. Pourquoi avoir attendu ?
J. C. : Je crois que ça ne nous aurait pas intéressés il y a quinze ans. La distance a rendu les choses plus intéressantes. On devait attendre l’exotisme du passé.
E. C. : Et peut-être que nos enfances ont été très sereines...
J. C. : Oui, c’est vrai. Ce n’est pas comme si on avait été pourchassés par les nazis ou battus par nos parents...
E. C. : Ou envoyés dans des écoles atroces...
J. C. : Ou en maison de correction. Nous n’avons rien à reprocher à nos parents, sauf de nous avoir privés d’une enfance intéressante.
C’est la première fois que vous traitez directement de l’expérience juive aux Etats-Unis. Une fois encore, pourquoi avoir senti la nécessité de le faire maintenant ?
J. C. : Le moment est arrivé où le sujet s’est mis à présenter de l’intérêt pour nous. Mais il faut noter que nous n’avons jamais évité délibérément d’en parler. Nous ne l’avons pas fait en utilisant notre propre expérience, mais il y a des éléments de l’expérience juive dans beaucoup de nos films.
Est-ce que votre désir de faire ce film est lié à l’histoire récente de la communauté juive, en Israël et dans la diaspora ?
J. C. : La condition juive dans la diaspora est ce qui nous a intéressés : le passage de ce que nous montrons dans le prologue - le shtetl en Europe de l’Est - à la réalité que nous avons vécue, l’étrangeté de cette transformation, sa spécificité. Je ne crois pas que ce soit lié aux événements récents, et toi ?
E. C. : Non. Cette histoire de diaspora est bizarre. Et nous n’en avions pas conscience quand nous étions enfants.
J. C. : Mais en y réfléchissant...
E. C. : ... des juifs dans les plaines du Midwest, c’est une chose extraordinaire. Qui est rendue plus bizarre par le souvenir du shtetl. Et cette histoire de modernité. Il y a quelque chose de drôle à associer les mots "juif" et "moderne", des juifs dans des avions.
J. C. : Bien sûr, l’héritage juif est à la source d’une grande part de la modernité, mais la communauté juive existe comme une entité traditionnelle dans un contexte de modernité, avec ces cheminées modernes, la musique pop. Sans l’avoir vécu, nous l’avons vu. A Minneapolis, il y avait une communauté loubavitch quand nous étions enfants. Nous avions déjà conscience de ce contraste entre cette communauté juive du Vieux Monde et les années 1960.
Il y a aussi le conflit entre la piété de la mère et la laïcité du père...
E. C. : Ça reflète de très près notre propre expérience, notre mère était beaucoup plus religieuse que notre père.
Avez-vous pensé aux références bibliques qu’on peut deviner dans l’histoire de Larry Gopnik dès le début ?
J. C. : Rétrospectivement, il nous semble logique que les gens fassent le lien avec le Livre de Job, parce que les malheurs s’abattent sur Job comme sur Larry Gopnik. Mais c’était la foi de Job qui était mise à l’épreuve, alors que c’est la résignation de Larry face à l’état des choses qui est remise en question – il n’est pas particulièrement croyant ou religieux.
Des rabbins , des théologiens ont-ils réagi au film ?
J. C. : Le rabbin qui nous a conseillés pendant le tournage a montré le film à un autre rabbin qui est professeur au séminaire juif de théologie - il forme d’autres rabbins . Il a dit qu’il aimerait utiliser notre film dans le cadre de cette formation, pour montrer ce qu’il ne faut pas faire.
Savez-vous quel sera votre prochain film ?
E. C. : Nous sommes presque sûrs que ce sera True Grit, d’après un roman de Charles Portis, qui a déjà été adapté avec John Wayne (Cent dollars pour un shérif, 1969).
Ce sera votre premier western ?
J. C. : Oui, avec des pistolets.
Et pas de rabbins ?
E. C. : Pas de rabbins .
J. C. : C’est une idée...
E. C. : Mais il y a déjà eu un western avec un rabbin ... c’était un film avec Gene Wilder.
Propos recueillis par T. Sotinel pour Le Monde
A serious man ou le judaïsme en panne
Voici une analyse intéressante trouvée sur un blog :
Qu’en est-il du judaïsme au filtre de la contre-culture, que valent les trois rabbins face au bombardement de Jefferson Airplane, les frères Coen répondent rien, une moisson d’énigmes, une quête inutile, un panneau the end qui annonce que le seul signe dont on soit certain, c’est la mort.
Dans le prologue yiddish couleur sepia, on apprend les ressorts de la foi, celle du charbonnier. Si tu rencontres un dybbuk, tue-le, le monde n’est que le voile d’un combat titanesque où les étincelles de la Shekhina campent au milieu de la misère et des âmes errantes et ce depuis la première respiration du monde, celle d’En-sof, de Dieu si on préfère. Le poinçon dans le cœur du rebbe possédé, la porte qui se ferme, sont comme la continuation du rite qui tient le foyer à la verticale de la sagesse. Hokhma est bien lointaine comme toutes les sephirot mais elle est à la portée du juste, à hauteur de piété.
Par la suite, l’homme juste dans le monde moderne naissant (paradis pavillonnaire, voiture, argent, ascension sociale, liberté des mœurs, réfection des familles, télévision et entertainment) devient l’homme désarmé par excellence. Il perd le contrôle de son frère, de sa femme, de ses enfants, de son boulot, de ses désirs, de son jugement, il parcourt en radar rouillé la suite des évènements comme un poulet décapité qui hurle, pleure, gémit, rêve et s’embourbe dans des questions sans réponses sinon celles de rabbins portés sur la thérapie comportementale.
Ce film sans pères, disparus dans les crématoires d’Auschwitz ou dans le gouffre qui brise en deux le temps de la rédemption devenue impossible porte en lui dans un simple plan l’énigme d’une question. Et si le sacrifice d’Isaac, représenté dans un tableau fugitif, consistait dans ce legs sans testament, ces rabbins séniles gardés par une armada de Cerbères féminins aux jambes de bœufs et ses jeunes lauréats de yeshivot qui croient découvrir la devekut dans les méandres d’un parking. Si le sacrifice c’était cela, la parole interrompue, le yiddish comme langue de personne, et l’hébreu, l’ivrit, langue liturgique tournant sur le mange-disque, avec son el Male Rachamim, chant de deuil transformé en numéro de music-hall par un rabbin impeccable que les lectures d’historiettes à la Martin Buber ont transformé en avocat de Dieu, en fondé de pouvoir de la synagogue comme d’autres le sont des intérêts de leurs clients.
Le Don’t you want somebody to love répond dès lors dans le lointain au Portnoy et son complexe de Joseph Roth, il dit l’appel, pour tout juif, le judaïsme n’est plus l’office ministériel de la piété, la communauté fermée à la Benny Lévy, c’est la question fichée à la croisée des chemins de traverse, un reste que rien ne vient effacer, une morsure qu’on ne comble pas en caftan et prières.
Memento Mouloud