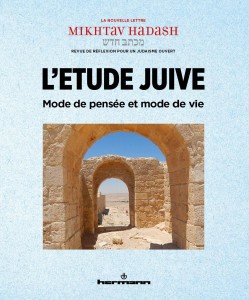Quiconque traverse Sde Nehemia a le sentiment de descendre le cours de son histoire, irréversible comme celui du Jourdain dont la source dévale sur son flanc ouest. Posé à l’extrême nord d’Israël, dans « le doigt de la Galilée » - cette vallée fertile enclavée entre la montagne libanaise et les hauteurs du Golan -, Sde Nehemia est un kibboutz en fin de vie, une communauté de 167 membres en voie d’achever la liquidation de soixante-huit ans de collectivisme.
On y croise, dans l’ordre : un silo desaffecté décoré d’une fresque où des jeunes dansent la hora (1) et un âne tire un araire, image des années 40 ; un local fermé de l’agence Reuters, base arrière de journalistes pendant la guerre du Liban de 1982 ; le vaste réfectoire qui fut le centre de gravité de la communauté et où personne ne vient plus déjeuner depuis 2005. En s’égarant par les sentiers bitumés, on verra des maisons coquettes, bordées de fleurs et pelouses émaillées d’abris anti-obus (le Liban est à 5 km, la Syrie était aussi proche avant l’annexion du Golan en 1967), une crèche avec ses balançoires et ses cris d’enfants, une piscine autrefois gratuite et à présent payante, une usine de plastique qui tourne encore pour la collectivité. Enfin, aux confins nords du kibboutz, on découvrira son avenir : le chantier d’où ont surgi de grosses villas desservies par de larges rues, vendues à des citadins au prix du marché.
Zvi Abendanan, 67 ans, habite à quelques centaines de mètres de ce nouveau quartier. Né Richard à Alger, c’est un acteur anonyme, « ordinaire », dit-il, de l’aventure kibboutzique, unique dans l’histoire des constructions sociales. Un témoin atypique, mûri loin du creuset doctrinaire.
Zvi est arrivé à Sde Nehemia en 1974, après onze ans à Petah Tikvah, faubourg populaire de Tel-Aviv. Venu de « la ville » dans ce microcosme rural inspiré par les idéaux de la révolution russe de 1905, il est de cette minorité de juifs des pays arabes qui ont choisi le kibboutz par idéal, s’y sont accrochés corps et âme pour s’intégrer tant bien que mal, en ont tiré « fierté et bonheur », et ont vécu avec un sentiment mêlé de nostalgie, d’amertume et de soulagement, sa lente mais sûre décomposition.
Vote pour le salariat
Zvi était venu là, à 33 ans, pour renouer avec le rêve qu’il caressait dans sa jeunesse algéroise, celui d’une société égalitaire, démocratique, solidaire, laïque et au grand air. Pas de salaires, les biens en commun, les besoins de chacun assurés par la collectivité (éducation, santé…), les décisions votées en assemblée générale. Et surtout, une économie fondée sur la culture de la terre et la culture tout court. « C’étaient les deux valeurs suprêmes, la clé de l’émancipation du peuple juif. Arrivé ici, j’ai tout de suite demandé à être aux champs », dit Zvi, devenu expert agricole, au-delà de ses rêves. Il a fait tous les métiers dans les agrumes, le coton, les avocats, les kiwis, et a créé des ruches (« un hobby »). A la demande du kibboutz, il appris une variété de professions sur le tas, à l’école et à la fac, pour son plus grand plaisir d’« éternel étudiant », lui qui est sorti du système scolaire avec un certificat d’études. « A chaque nouveau travail, j’ai demandé une formation, dit-il. J’ai été chargé du contrôle qualité à l’usine de plastique, j’ai créé et dirigé la maison pour personnes dépendantes, ouverte en 1998 par le kibboutz, après avoir été responsable des questions de santé et secrétaire général du kibboutz. »
C’est de ce poste-là, au cœur du système, que Zvi Abendanan voit monter les débats annonciateurs de la fin du collectivisme. « En assemblée générale, des membres ont commencé à parler de "changement", c’était le mot politiquement correct pour la privatisation » , dit-il avec agacement. Plusieurs kibboutz s’étaient engagés sur cette voie depuis le début des années 90 après avoir perdu beaucoup d’argent en Bourse. Mais Sde Nehemia était bien géré. Il avait été fondé en 1940 par une quarantaine de Hollandais, Viennois et Tchécoslovaques, austères, qui avaient le sens de la gestion rigoureuse. Jamais une dette. Il n’empêche.
« On a suivi le chemin tracé ailleurs, de façon grégaire. Avec, au début, le leitmotiv des kibboutz endettés : faire des économies, mettre un prix sur chaque chose, pour chaque personne », raconte Zvi. Première cible : la gabegie des repas offerts matin, midi et soir au réfectoire, en self-service. « On a évalué le prix d’un repas. » Puis, celui de l’électricité… Et enfin, le prix du travail. Un audit détermine combien rapporte un ouvrier au champ, à l’usine, un cadre. « Et on a commencé à parler de "salaires différenciés". »
« Trop bolchevique »
Résultat, en 2005, les kibboutzniks votent à la majorité pour l’instauration du salariat. Pratiquement du jour au lendemain, les uns passent cadres, les autres ouvriers. La cantine devient payante, l’électricité aussi, en partie. Est venu le tour de la pièce maîtresse : le logement. Le kibboutz fournissait à chaque famille une maison selon sa taille. « En 2005, des experts ont évalué les maisons, et chacun a fait ses comptes. En fonction du nombre d’années travaillées au kibboutz, celui-ci nous devait une somme. Si la maison coûtait plus, on devait la différence. Sinon, le kibboutz nous devait de l’argent », explique Zvi. Il devient ainsi propriétaire de sa maison de 80 m2 avec jardin. C’est l’heureux point d’orgue d’un effondrement qu’il s’explique avec le regret critique de celui « qui a toujours été minoritaire ».
« Le kibboutz est mort non pas tant à cause du libéralisme ambiant ou de la crise économique, estime-t-il. Mais de sa sclérose. C’était une société révolutionnaire. Elle a produit une société normative qui n’a pas su évoluer, qui n’aime ni les femmes divorcées, ni les célibataires, ni les homosexuels, et qui réserve aux femmes les travaux dans la cuisine, l’habillement, la crèche. » « Le système de gouvernance était trop bolchevique, reprend-il. Tout se votait chaque semaine en assemblée générale au suffrage direct. Mais c’était le royaume du lobbying. Quand j’étais secrétaire général, j’ai tenté une réforme : les membres élisaient des représentants et on fonctionnait comme un parlement. Mais ça n’a pas tenu au-delà de mon mandat. Le démantèlement du système était en route. » « Il faut avoir une peau d’éléphant pour vivre au kibboutz, confie-t-il. Pas de sanction mais pas de gratification. »
Ce n’était pas tout à fait ce monde-là que Zvi imaginait, quand, adolescent dans une Algérie secouée par les attentats, il rêvait de partir vivre en Israël. A l’instar de son père, directeur d’une maison de commerce, il était convaincu que l’Algérie ne resterait pas française car « chaque peuple a le droit de vivre dans un Etat indépendant, de prendre en main son destin. Les Arabes d’Algérie, et les juifs. J’étais alors certain que l’Algérie serait le premier Etat arabe socialiste et laïc. » A 15 ans, en 1958, il entre dans un mouvement de jeunesse sioniste, un groupuscule d’une trentaine de jeunes : Israël est alors une réalité virtuelle pour les juifs d’Algérie, citoyens français. Il signe avec ses copains un manifeste antimilitariste… invoquant Sartre à l’appui du refus de servir en Algérie. En 1958, il part faire un stage dans un kibboutz. En 1960, il émigre, le cœur léger.
Locations aux vacanciers
« Les frontières étaient calmes. On croyait que la paix était pour demain, que l’armée et la guerre serait un souvenir. » Il arrive au kibboutz Hanita et, jeune homme de belle carrure, se voit devenir un vrai kibboutznik, dans le sillage des pionniers. L’histoire en décide autrement. Ses parents débarquent à Tel-Aviv en 1962, à l’indépendance de l’Algérie. Il doit les aider. Il trouve du boulot dans la capitale, dans le bâtiment, puis entre, contre toute attente, dans la police. Après la guerre de 1973 (« un choc »), il en a « ras-le-bol » de la ville et de ses noirceurs. Il cherche un kibboutz d’accueil et débarque à Sde Nehemia avec sa femme et ses deux filles. « Le paradis, les montagnes, le Jourdain. » Un troisième enfant naît, « l’enfant du bonheur ». Mais Sde Nehemia n’est pas un jardin de roses. « Dans la police, on me traitait de kibboutznik. I ci on me regardait comme un policier. Avec méfiance. On a dû attendre deux ans au lieu d’un avant de devenir membre de la communauté. »
Trente-quatre plus tard, c’est le système collectiviste qui est rejeté par la communauté. Sde Nehemia est en voie de devenir un village ordinaire. Des maisons sont louées à des vacanciers, et les mentalités changent. « On l’a vu durant la dernière guerre du Liban, l’été 2006. Pour la première fois, les gens ont quitté le kibboutz en masse. Il est resté les vieux et ceux comme nous, qui ont leurs vieux parents. Avant, c’était un devoir de rester, quitte à passer des jours dans les abris. » Il faut dire qu’en 2006, « ça a tapé jour et nuit durant trois semaines ». « Je préfère effacer cette période de ma mémoire », dit-il. Et cultiver son jardin de cactus et ses études d’histoire européenne, dévorer Michel Winock et visiter ses ruches, en attendant l’issue des négociations sur le Golan, et celle du kibboutz. « Il reste à privatiser l’usine, les champs », résume le futur ex-kibboutznik.
Sa fille cadette, Eynat, professeur d’art dans un kibboutz voisin se souvient de la honte d’avoir porté, enfant, des chaussures différentes des autres enfants du kibboutz, catégorie « citadine, donc bourgeoise ». Après ses deux ans de service militaire, elle a voyagé en Asie et en Europe, vivant de petits boulots. De retour à Sde Nehemia, elle n’imagine pas vivre ailleurs. « C’est le plus bel endroit au monde », dit-elle. Les propriétaires des cinquante villas du nouveau quartier du kibboutz le pensent sans doute aussi. Venus des villes voisines où ils travaillent, ils façonneront bientôt, à voix égale avec les « anciens », l’avenir de Sde Nehemia : une jolie bourgade de Galilée.