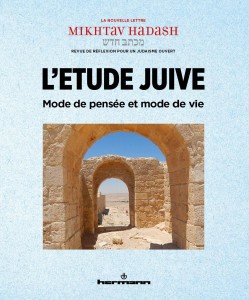Se réjouir de la victoire ?
Tout celui qui a participé au sédér traditionnel, la veillée pascale, connaît ce passage où les maîtres d’Israël rivalisent pour prouver que le miracle attaché à ce passage de la mer a été beaucoup plus important que les miracles de la sortie d’Egypte elle-même.
Pourtant, le Shabbat au cours duquel nous lisons la parashat Beshalach est entré dans la tradition nom sous le nom de "shabbat de la mer rouge" mais sous le nom de "shabbat shira", le shabbat du cantique. Ce cantique est celui qui est entonné par Moïse et repris par les enfants d’Israël après la traversée et l’engloutissement de l’armée égyptienne dans les profondeurs de la mer : action de grâce à la poésie extraordinaire et qui fait partie de la liturgie quotidienne du Judaïsme. En quelque sorte, la tradition d’Israël affirme que le plus important dans l’évènement de la traversée de la mer rouge est constitué par la capacité des enfants d’Israël de célébrer la destruction de l’ennemi.
Cette capacité de se réjouir de la victoire n’est pas une évidence. Le texte de la Torah nous montre d’ailleurs que Moïse a du prendre l’initiative pour que les enfants d’Israël se joignent à lui : "Az yashir Moshé oubené Israël et hashira hazot lashem vayomérou lémor (alors Moïse chantera ainsi que les enfants d’Israël ce cantique à l’Eternel et ils diront pour dire – Exode, 15, 1). Sans le caractère du leader, il n’est pas sûr que le peuple ait trouvé en lui-même cette possibilité de célébration immédiate. Mais pourquoi est-ce si difficile de se réjouir de la victoire ? Nous pouvons trouver deux réponses différentes et complémentaires.
La première se trouve dans le livre de l’Ecclésiaste (Kohelet), au verset 7 du chapitre 3. Il s’agit d’un passage très connu de ce livre de sagesse, passage qui commence par la fameuse expression : "il y a un temps pour tout". Le verset 7 s’énonce ainsi : "éte likroa vééte litfor, éte lachashot véete lédaber" (un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler). Il est important de comprendre la construction du verset : au premier verbe, correspond le troisième, au second le quatrième. En quelque sorte, nous pouvons lire le texte de cette manière : lorsque c’est le temps de déchirer, c’est également le temps d’être silencieux, par contre lorsque vient le temps de réunir, de refermer, c’est alors le temps de parler. Ce temps de parler, Rashi le relie dans son commentaire à notre cantique de la mer rouge. Or, le terme déchirer (likroa), premier verbe du passage, est celui que la tradition juive emploie pour désigner l’ouverture de la mer rouge.
Peut-être pouvons-nous ainsi adapter ce verset de l’Ecclésiaste à l’événement de la mer rouge : au moment où la mer a été ouverte (likroa) par Dieu, la situation est telle qu’elle ne peut laisser les enfants d’Israël que muet (lachashot) de stupeur, et peut-être de peur tout simplement. La menace représentée par les troupes égyptiennes paralyse l’expression orale. Mais quand la mer se referme sur Pharaon et son armée, il faut trouver la capacité de sortir de cette stupeur pour parler, témoigner, louer. Mais ce passage du silence à la parole n’a rien d’évident, il faut tout un travail intérieur et l’aide du leader est alors indispensable pour le réaliser.
La deuxième difficulté est fort bien exprimée par un célèbre midrash : "Au même moment (lorsque Moïse entonna le cantique) les anges du service demandèrent à dire un cantique devant le Saint-béni soit-il, celui-ci leur dit : les créatures de mes mains sont en train de se noyer, et vous voulez dire un cantique de grâce ! (traité sanhédrine du Talmud de Babylone)". Le midrash pose en quelque sorte ce dilemme : nous qui croyons au Dieu unique et universel, avons-nous le droit de nous réjouir de la mort de nos ennemis qui sont aussi ses créatures ? D’un autre côté, c’est la main de Dieu qui a précipité nos ennemis dans les flots, ne devons nous donc pas lui rendre hommage par notre joie ?
Cette contradiction est analysée par deux maîtres d’Israël : dans le Talmud , à la suite de ce midrash , Rabbi Yossi bar Chanina ajoute : "Il (Dieu) ne se réjouit pas, mais il réjouit les autres" ! Si au niveau des êtres célestes, il n’est pas autorisé de se réjouir de la mort d’autres êtres humains, au niveau humain, la joie est de règle. On comprend l’importance de ce cantique de Moïse, et la raison de la place d’honneur accordée à la Shira dans nos prières. D’un autre côté, Rabbi Aharon Hacohen de Narbonne, dans son important traité de lois "Kol bo", précise que c’est à la suite de ce midrash qu’il a été décidé que pendant les derniers jours de la fête de Pessach, période anniversaire de la traversée de la mer rouge, le Hallel , les louanges de joie de la fête, ne sera dit que partiellement, pour limiter notre joie en souvenir des morts des Egyptiens.
Allégresse pleine et entière d’un côté, compassion de l’autre, la liturgie juive est le témoin de cette difficulté à être pleinement humain tout en imitant également les voies de Dieu.
Rabbin Alain Michel – Rabbin à Jérusalem et historien
copyright Jerusalem Post
La lecture juste
Notre parachah nous transporte sur un nuage de merveilleux : la nuée qui nous guide dans le désert, le passage de la mer des Joncs, les eaux de Marah, la manne… Laissons-nous donc guider par un Dieu qui prévient tous nos désirs, remplit toutes nos attentes, met fin à toutes nos angoisses… Quoi de plus grisant en effet que ce passage de la mer des Joncs où la plus puissante armée du monde est mise en déroute par un peuple de gueux et d’esclaves, sans qu’ils aient même dû lever la main contre elle ? Ou que cette manne qui nous nourrit chaque jour et s’arrête le Chabat ? On croit rêver ! Miracle, miracle, miracle !
Et tout d’un coup, on ne comprend plus : à peine le peuple, en arrivant à Refidim (Exode 17, 1), découvre-t-il qu’il n’y a pas d’eau (ils n’auront soif que plus tard, au verset 3), qu’il se révolte et semble remettre en cause la possibilité même de l’existence divine : « La Transcendance existe-t-elle au milieu de nous, ou non (néant !) » (Exode 17, 7).
Comment une telle question est-elle seulement possible après autant de miracles ? Il faut être stupide !
Pas du tout : il suffit d’agir comme un enfant gâté (voir Rachi ). C’est-à-dire de ne pas entendre tous ces « miracles » comme des signes destinés à nous éduquer et à nous responsabiliser, mais comme des fins en eux-mêmes, visant au simple comblement de nos manques, à la pure satisfaction de nos besoins, au cloisonnement de nos certitudes dans la maîtrise totale que le divin nous assure.
Le divin est alors réduit à bien peu, et son action n’est plus perçue comme un signe (‘ot et nes) destiné à être lu, interprété et reversé dans notre action pour aller de l’avant, mais comme un prodige (mofet) destiné à servir l’humain auquel il s’adresse.
Ce n’est plus l’homme qui se découvre interpellé par un signe au service de la Transcendance qui l’appelle, c’est le bébé qui se doit d’être comblé immédiatement par un sein tout-puissant et consolateur.
Ce n’est plus l’homme qui est appelé à servir Dieu et à agir en conséquence dans l’histoire, c’est Dieu qui est appelé à servir l’homme et à le consoler de tous ses manques – à le combler et à l’épanouir.
C’est le problème du religieux, c’est-à-dire de toute proximité recherchée avec le divin : je peux me sentir tellement proche de Dieu que je colle à lui, m’identifie à lui et croit qu’il s’est identifié à moi et à mon désir – d’où la déconvenue et la récrimination lorsqu’il s’avère qu’il n’en est pas ainsi, et que Dieu n’est pas toujours le « bon Dieu »...
Car je ne perçois plus alors que c’est seulement par la distance qu’il peut me parler et me commander, c’est-à-dire m’exiger à moi-même à travers mes actes. Et la distance suppose qu’il ne soit pas là où je l’attendrais, qu’il me surprenne et continue à m’interpeller au-delà de mes attentes, de mes prévisions et de mes besoins.
Deux types de lectures de la Torah sont ainsi départagées par cet épisode : s’agit-il de lire la Torah comme un livre de foi, pour apprendre à tout attendre de Dieu qui un jour nous fera des prodiges et nous délivrera de tout mal ? Ou de la lire comme un livre de signes, qui nous appelle à interpréter ces signes pour les faire agir dans notre histoire – pour nous faire agir dans une histoire qui sera désormais nôtre face à Dieu ?
Autrement dit, l’important est-il que cela se soit vraiment passé – et de se laisser ainsi fasciné par la puissance divine dans une pure foi sans discernement qui attend tout de Dieu – ou au contraire l’important est-il que ces signes soient le moyen pour l’Absolu de se retirer de l’histoire – de faire chabat - pour en appeler à l’homme et à sa responsabilité pleine et entière d’adulte, par-delà les fantasmes de l’enfant ?
Un très beau et très ancien midrach répond à cette question de la manière suivante : « A propos du verset : « Voici que je me tiens là-bas debout devant toi » (Exode 17, 6). Le Saint béni est-il à dit à Moïse : « dans tout lieu où tu découvres la trace des pas de l’homme, là Je suis devant toi » (Mekhilta).
Comme si la présence divine se tenait encore debout devant nous – était encore accessible -, non plus dans le miracle ou l’évidence perceptible, mais dans le retrait où elle laisse place aux pas de l’homme, à son avancée dans l’histoire, à sa responsabilité propre et irréductible.
Celui qui est capable d’entendre ainsi la présence divine au creux des traces de l’homme et de son action, peut frapper le rocher du réel pour le transformer en source d’eaux vives (Exode 17,6). Lui peut nous donner cette Torah, en nous avertissant qu’elle peut être à la fois occasion de régression ou de progression, de mort ou de vie : « La vie et la mort, j’ai donné devant toi, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie… » (Deutéronome 30,19).
La Torah nous révèle ainsi que c’est à nous de choisir l’avenir que nous construirons, et à nul autre à notre place.
Yedidiah Robberechts
Etude du Cantique de la mer
par Philippe Chriqui
A lire sur le pdf