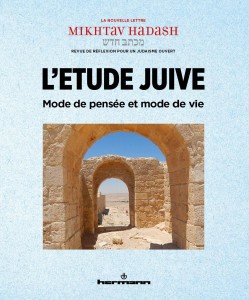Durant de nombreuses années, j’ai raconté dans des écoles et des lycées, l’essentiel de mon vécu. L’intérêt et l’attention soutenue, que ces jeunes ont manifesté, ainsi que les lettres et dessins reçus par la suite, m’ont incité à tenter l’aventure de l’écriture.
Mon souhait, téméraire peut-être, serait que mon récit soit joint au livre d’histoire scolaire, afin de compléter les connaissances des élèves et perpétuer la mémoire de cette triste période.
PAUL SCHAFFER
texte intégral :
Préface de Madame Simone Veil
Soixante ans après son arrestation et sa déportation, Paul Schaffer a décidé d’écrire son histoire, celle que vous allez lire et qui est, à bien des égards, exemplaire. Exemplaire, parce que les événements qui ont bouleversé son existence, ont de la même façon bouleversée la vie de nombreux adolescents, qui ont survécu à la déportation, mais dont les familles ont le plus souvent entièrement disparu, simplement parce qu’ils étaient juifs.
Pour la France, seule, 76.000 Juifs ont été déportés, moins de 3.000 sont rentrés, parmi lesquels la plus part était des jeunes gens et jeunes filles. A leur retour du camp ils n’ont retrouvé ni famille, ni ami, ni argent, aucun souvenir matériel qui puisse évoquer leur passé. Les appartements, de leurs parents avaient été totalement vidés par les Allemands, quand ça n’était pas par des voisins.
Leurs seuls souvenirs étaient dans leur cœur et leur tête : le bonheur d’une enfance choyée qui fut brutalement interrompue par la déportation et la disparition dans des chambres à gaz de tous ceux qu’ils aimaient.
A ces souvenirs, se surajoutaient ceux des atrocités et de la violence, de l’inhumanité de l’enfer concentrationnaire dont ils étaient sortis par miracle.
N’ayant pu aller normalement en classe, trop jeunes pour avoir acquis une formation professionnelle, ils ont dû tout reconstruire et d’abord eux-mêmes en réapprenant à vivre. Ce n’était pas facile de retrouver une vie normale, ni même d’en donner l’apparence.
Souvent, ils ont rapidement fondé une famille, même s’ils savaient qu’elle ne remplacerait jamais celle qui avait disparu dans la tourmente.
Pour reprendre goût à la vie, il leur fallait une atmosphère de tendresse et de bonheur pour essayer de remplacer celle qu’ils avaient connue.
Pour autant, leur douloureux passé n’a cessé de les hanter, même si pendant longtemps ils n’en ont guère parlé…
Si certains ont préféré garder le silence, se sentant incapables de concilier, dans leur esprit, le présent et le passé et d’imposer à leurs proches le poids de leurs souvenirs, d’autres ont été contraints au silence parce que, dès leur retour, ils se sont heurtés à l’incrédulité ou à l’indifférence. Cette indifférence cachait en réalité la difficulté pour les « autres » de supporter la distance et l’incompréhension qui les séparaient de ceux qui étaient rentrés.
Un mur qui paraissait infranchissable s’est ainsi élevé entre les anciens déportés, revenus d’un monde qui n’avait plus rien d’humain, ceux dont on pourrait dire qu’ils étaient passés de l’autre côté du miroir, et les autres.
C’est donc entre nous que, pendant des années, nous, anciens déportés, nous sommes retrouvés pour parler inlassablement, dans un langage plus ou moins codé, de ce que nous avions vécu. Nous avons ressassé nos souvenirs, retrouvé la fraternité qui nous avait permis de survivre, évoquant les moments les plus cruels, souvent avec dérision, seule façon pour pouvoir en parler, même entre nous.
La déportation a créé des sentiments d’appartenance à un monde à part. Quelles que soient nos différences et divergences existantes, l’expérience que nous avons vécue nous amène à voir la vie d’une autre façon.
Les années ont passé, les temps ont changé. Les nouvelles générations, mieux à même de nous écouter parce que moins directement concernées, plus curieuses de nous entendre, nous ont incités à parler. En vieillissant, nous avons pris conscience de la nécessité de transmettre notre témoignage, de ce que nous avions vu et vécu afin que l’Histoire s’en empare. Nous avons ainsi tenu l’engagement, pris vis à vis de nos camarades, que nous avions vu mourir dans des conditions abominables, de parler pour que l’on n’oublie pas.
Bien que leurs témoignages aient été longtemps dédaignés, voire rejetés par la plupart des historiens, au motif que les victimes déformant nécessairement la vérité, ne sont pas crédibles, les anciens déportés ont été de plus en plus nombreux à prendre la parole ou la plume. La volonté de répondre à la diffusion des thèses négationnistes et le souci de ne pas laisser à des films et des romans de fiction l’exclusivité d’une représentation de la déportation, parfois très éloignée des réalités, ont fait prendre conscience de l’intérêt de recueillir les témoignages des survivants lorsqu’il en était encore temps. Divers organismes s’y sont employés, et les éditeurs ont été plus disposés à publier leurs récits.
Pour Paul Schaffer, c’est surtout le sentiment d’un devoir à accomplir avant de disparaître, quelles que soient les difficultés et la douleur que ce travail d’écriture et de mémoire lui aient imposés, qui l’a conduit à écrire le présent ouvrage.
Il ne s’agissait pas seulement de parler de la période particulièrement cruelle de sa vie, les persécutions en Autriche, la fuite en Belgique, l’exode vers la France, des années de vie clandestine, l’arrestation, la déportation avec sa mère et sa sœur, qui ont été gazées dès leur arrivée à Auschwitz. Il tenait aussi à évoquer la vie de famille avec sa sœur, ses parents et grands-parents ainsi que tous ceux qui avaient fait partie de son existence d’enfant, lorsqu’ils habitaient à Vienne avant l’anschluss. A tous, à travers son récit, il exprime sa reconnaissance pour le bonheur qu’ils lui ont donné et dont il a toujours conservé le souvenir au fond de son cœur, certes avec tristesse, mais aussi une très grande tendresse. C’était le bonheur simple d’un petit garçon au sein d’une famille unie, celui des vacances, des longues promenades et des goûters chez le meilleur pâtissier, c’était aussi la classe et les jeux avec ses camarades ou encore son attachement à sa collection de timbres à laquelle il tenait tant qu’il l’avait emportée avec lui, en cachette, lorsque la famille a été contrainte de fuir l’Autriche.
Le malheur qui s’abat sur sa famille comblée n’en paraît que plus dramatique, et les souvenirs ainsi retracés, des décennies plus tard, traduisent parfaitement la stupeur et le total désarroi qu’ont pu éprouver avant la guerre, les Juifs allemands et autrichiens, pourtant totalement intégrés, face aux persécutions.
De tous ces événements, Paul parle avec lucidité et sans concession mais sans amertume pour lui-même, autre que l’inquiétude et la douleur qu’il éprouve pour les siens tout au long de ces épreuves qui ont précédé le drame.
L’attention qu’il a toujours portée aux autres, plutôt qu’à lui-même, étonne chez un adolescent de cet âge. A chaque fois que ses parents sont contraints de fuir, de se cacher, tout en s’organisant pour recréer un nouveau cadre familial, le jeune Paul ne se plaint jamais, ne se laisse jamais abattre : il s’intéresse à tout, apprend le français et le travail d’ébéniste, puisqu’il ne peut aller en classe. Les relations avec la population de Revel, où la famille a trouvé refuge, en seront très favorisées. A l’aide courageuse que leur ont apportée certains habitants de cette petite ville du Sud-Ouest, il porte davantage d’importance qu’à l’attitude des gendarmes qui ont arrêté sa famille et se sont acharnés à le retrouver après une courte évasion.
Des bons et mauvais souvenirs de Revel, il parle plus volontiers des premiers. Alors qu’il a vécu moins de deux ans en France, c’est sans hésiter qu’il y reviendra dès sa libération du camp.
Ayant fait la connaissance de Paul en déportation, je sais que cette attitude dénuée d’ostracisme et de haine ne date pas d’aujourd’hui, elle n’a pas été imaginée pour les besoins de son histoire. Elle traduit sa véritable personnalité qui n’a jamais été atteinte par les atrocités, la violence et les humiliations du camp – ce qui ne donne que plus de prix à son récit.
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au début du mois de juillet 1944 à Bobrek, petit commando situé à quelques kilomètres d’Auschwitz-Birkenau, un immense camp d’extermination.
Nous étions environ trois cents déportés, dont seulement une trentaine de femmes. Celles-ci étaient pour la plupart affectées à des travaux du bâtiment et de terrassement, alors que les hommes travaillaient généralement dans l’usine. L’espace du camp étant très réduit, les hommes et les femmes avaient l’occasion de se rencontrer, et même de nouer des relations amicales, bien que non tolérées. Ces relations ont perduré jusqu’à ce jour, plus particulièrement entre ceux qui avaient été déportés de France.
Paul avait alors dix-neuf ans. Bien que déporté déjà depuis près de deux ans dans un autre camp proche d’Auschwitz, il avait su préserver des qualités humaines tout à fait exceptionnelles qui contrastaient avec l’ambiance de brutalité qui régnait dans le camp. Sa dignité, sa gentillesse vis à vis de tous, une certaine forme de civilité, m’apparaissent encore aujourd’hui comme la plus belle victoire sur un système concentrationnaire conçu pour nous humilier et nous réduire à un état quasi-bestial.
Même s’il pressentait que sa mère et sa sœur, comme la plupart des déportés de leur convoi, avaient été gazées dès leur arrivée à Auschwitz, il ne s’est pas abandonné au désespoir. Il voulait survivre, il l’a fait sans jamais s’abaisser à quoi que ce soit et en cherchant toujours à aider les autres.
Outre sa force de caractère, il a su, au bon moment, faire preuve de lucidité et de courage pour prendre des décisions parfois risquées, mais qui lui paraissaient donner une plus grande chance de survivre.
Comme tous ceux qui étaient à Bobrek, nous avions eu l’un et l’autre de la chance d’être envoyés dans ce commando. Pour certains c’était la chance d’avoir bénéficié de la sympathie ou la pitié d’un responsable du camp, ce qui fut mon cas. En ce qui concerne Paul, c’est lui qui a saisi sa chance.
Pour ce faire, alors que la plupart de ses camarades espérant échapper aux travaux les plus pénibles se disaient étudiants, il avait déclaré à son arrivée au camp, ce qui naturellement n’était pas vrai, qu’il avait une formation de métallurgiste et qu’il était donc qualifié pour travailler dans une usine. Il fallait pour cela beaucoup de présence d’esprit et aussi beaucoup d’audace. Il savait en effet qu’on allait lui faire faire un essai et que cet essai ne serait pas très concluant. Ce fut bien évidemment le cas, mais il devait porter en lui quelque chose de particulier, un désir de vivre, une faculté de donner à penser à son interlocuteur qu’il serait capable d’apprendre.
De même, lorsqu’en janvier 1945 l’Armée soviétique approchant d’Auschwitz, nous fûmes tous poussés sur la route dans une longue marche forcée vers l’Ouest, il n’hésita pas à prendre le risque de sauter du wagon avec un de ses camarades dans l’espoir de se cacher jusqu’à l’arrivée des soldats russes. Il savait pourtant que s’il était retrouvé par les SS ou dénoncé par des habitants de la région, il serait abattu sur place. Après quelques jours d’errance et de danger dans la zone des combats, il a été libéré.
Il avait ainsi échappé à un transport de plusieurs jours en wagon découvert, par un froid glacial, au cours duquel beaucoup de déportés sont morts, de faim et d’épuisement. Cette évasion, jugée trop risquée par la plupart, lui a permis de réduire de quelques mois sa déportation, pendant lesquels le typhus et la faim ont provoqué la mort d’un grand nombre de déportés, très peu de temps avant la fin de la guerre. Là où certains ont hésité et renoncé, il avait eu l’instinct de se dire « j’ai une chance, maintenant, tout de suite, je dois la saisir ».
Amoureux d’une jeune-fille qui faisait partie de notre petit groupe de femmes, Paul renonce à s’évader durant la « marche de la mort » ne voulant pas la laisser en danger derrière lui. Elle ne voulait pas le suivre parce qu’elle avait l’espoir de retrouver son frère également déporté. C’est avec difficulté que Paul l’a effectivement retrouvé au camp de Gleiwitz où nous nous sommes arrêtés avant notre embarquement sur les trains.
Lui-même évoque cette idylle avec cette jeune-fille, ce qui m’autorise à en parler et à dire combien nous étions tous émus par l’amour de ces deux jeunes gens.
Cette histoire très romantique nous montrait que, même au camp, il y avait place pour des sentiments purs et désintéressés. Elle apportait à chacun d’entre nous, une part de rêve qui faisait tellement défaut dans notre vie misérable.
Le récit de Paul ne s’arrête pas à la libération et à son retour.
A peine arrivée en France, il avait eu la douleur d’apprendre que son père était mort à l’hôpital de Revel peu après la déportation de sa femme et de ses enfants.
De ses difficultés dans les années qui ont suivi, de sa volonté d’apprendre et d’entreprendre, il parle peu. C’est pourtant un long et difficile parcours qu’a été le sien, se retrouvant en France sans famille, sans relation, sans argent, sans formation professionnelle ni diplôme.
Il ne dit pas combien il lui a fallu d’énergie et de courage pour s’intégrer dans un pays qu’il ne connaissait qu’à travers la vie d’une petite ville.
Après avoir suivi une formation d’ingénieur qu’il termine dans un établissement de l’ORT, il y est resté quelques années comme professeur. Très apprécié, il aurait pu y faire carrière. Mais conscient de ses capacités, il souhaitait trouver un emploi où il puisse avoir des responsabilités. Engagé dans un petit atelier comptant une vingtaine d’ouvriers, il est devenu rapidement associé de cette affaire, avant d’en être chef de cette entreprise.
Lorsqu’il a vendu trente ans après, regretté de tous, cette usine employait 300 ouvriers et se trouvait parmi les plus modernes et importantes dans son domaine.
Ce n’est pas sans une certaine nostalgie qu’il a renoncé à se séparer de ce qu’il avait créé au cours de ces années de travail avec une équipe qui lui était très attachée, mais il songeait à sa famille et tenait à servir des causes essentielles pour lui, auxquelles il n’avait pu jusque-là se consacrer comme il l’aurait souhaité.
C’est au sein de l’Association France-Israël, dont il devint vice-Président qu’il œuvre maintenant pour l’amitié entre ces deux pays, conciliant ainsi l’amour qu’il porte à son pays d’adoption, la France, et sa foi en Israël, où il avait été tenté de s’installer au retour de sa déportation.
Mais davantage encore, c’est l’entretien de la Mémoire de la Shoah et de la déportation qui accapare son temps : déjà actif dans diverses associations d’anciens déportés, il témoigne de plus en plus souvent dans des établissements scolaires pour que les nouvelles générations, qui n’ont pas vécu ces événements, sachent ce qui s’est passé et en tirent la leçon.
De ces rencontres avec les jeunes, il tire lui-même une grande richesse car il sait retenir leur intérêt, susciter leur émotion et nouer avec eux des relations de confiance et d’amitié très exceptionnelle. C’est là une tâche éprouvante et difficile, car il s’agit pour tout ancien déporté, de parler d’un passé resté très douloureux et de trouver le ton juste, pour évoquer des réalités atroces, sans traumatiser de jeunes esprits.
Comment parler d’événements qui paraissent nécessairement très lointains, alors que la télévision montre chaque jour en direct tous les conflits et drames de la planète ?
Comment faire comprendre aux élèves la spécificité de la Shoah et les aider à en tirer une leçon qui s’inscrive dans le présent, sans pour autant banaliser le passé ?
La sobriété et l’authenticité du récit de Paul Schaffer lui confèrent une émotion particulière. Le message qu’il transmet n’en acquiert que plus de prix.
On ne peut douter que, comme auprès des enfants auxquels l’auteur s’est si souvent adressé, Paul ne trouve auprès de ses lecteurs la même sympathie et la même connivence.
Aux uns et aux autres, il donne l’exemple d’un jeune homme qui a su résister au malheur, aux humiliations et aux souffrances de la vie concentrationnaire pour rester un être humain.
De l’image qu’il donne des anciens déportés, de la confiance en l’humanité qu’il a su garder, qu’il soit remercié.