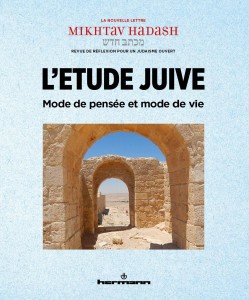Juin 1982. Première Guerre du Liban. Un char solitaire et un peloton de parachutistes sont expédiés pour fouiller une ville hostile. Mission simple qui se transforme en cauchemar. Les quatre membres de l’équipage se mettent dans une situation violente qu’ils ne peuvent pas maîtriser. Motivés par la crainte et l’instinct de base de survie, ils essayent désespérément de ne pas se perdre dans le chaos de la guerre.
Ce film montre notamment le décalage entre le soldat qui ne sait rien et doit être prêt à mourir et à tuer et un monde politique qui par ses décisions jette une génération dans la guerre.
Le point de vue du simple soldat enfermé dans son tank montre combien une vie peut tout d’un coup basculer dans la monstruosité que produit n’importe quel conflit et qui tout en dépassant l’individu l’entraîne dans un monde qu’il n’a pas choisi et qu’il ne peut fuir ou même gérer.
Shmouel Maoz témoigne de cette tragédie en amenant le spectateur à partager le petit habitacle puant et dangereux de son tank...
Il nous dresse au passage quelques portraits de soldats, durs et moins durs, compétant ou pas, mais partageant tous le même destin : le bourbier libanais.
Une fois de plus un réalisateur israélien apporte une note très particulière au thème de la guerre si souvent filmée, mais rarement avec une telle force et une telle vérité.
Comme il le dit lui-même : "Je venais d’avoir 19 ans en mai 1982. La vie était belle. J’étais amoureux. Ensuite on m’a demandé de partir sur une base militaire et d’être le tireur du premier tank à traverser la frontière libanaise. Cela devait être une mission d’une journée toute simple mais ce fut une journée en enfer. Je n’avais jamais tué quelqu’un avant cette terrible journée. Je suis devenu une vraie machine à tuer. Quelque chose là-bas est mort en moi. Sortir ce tank de ma tête m’a pris plus de 20 ans. C’est mon histoire."
Du très bon cinéma.
Yeshaya Dalsace
Fiche technique
Réalisé par Samuel Maoz
Avec Yoav Donat, Itay Tiran, Oshri Cohen
Durée : 01h32min
Année de production : 2009
Récompenses : Lion d’or à la Mostra de Venise 2009.
La critique enthousiaste
Libération salue « un film antimilitariste » et Le Figaro « une véritable expérience de la guerre ». De même, Excessif affirme que ce « beau film » « fascine d’un bout à l’autre » et Télérama apprécie ce « huis clos saisissant ». Le Point trouve le film « minimaliste » mais souligne qu’il « propose un maelström de sensations », tout comme L’Express qui retient une « expérience proprement viscérale » et Le Nouvel Observateur qui souligne « la force organique du film ».
Critique du Monde
Refusé au Festival de Cannes par toutes les sections (de la Sélection officielle à la Semaine de la critique en passant par la Quinzaine des réalisateurs), Lebanon s’est imposé quelques mois plus tard comme un Lion d’or indiscutable à la Mostra de Venise. Voilà qui relativise le jugement sacro-saint des sélectionneurs, et prouve en même temps qu’aucun film ne fait jamais tout à fait l’unanimité, chacun ayant ses raisons de plébisciter ou de rejeter l’oeuvre en fonction de critères qui sont affaire de goût, de subjectivité, d’idéologie.
Ce film, le premier réalisé par Samuel Maoz, se situe dans le sillage d’autres oeuvres retraçant, comme lui, la première guerre du Liban d’un point de vue israélien. Les plus connus sont Beaufort (2007), de Joseph Cedar, qui, dépeignant les derniers jours d’une forteresse israélienne assiégée par le Hezbollah, reçut l’Ours d’argent au Festival de Berlin. Et Valse avec Bachir (2008), d’Ari Folman, qui retraçait, par le biais du cinéma d’animation, l’invasion israélienne du sud du Liban en 1982 et la nuit du massacre des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila.
Le terme "point de vue israélien" n’est pas tout à fait exact. Lebanon et ces deux précédents films ont ceci de commun qu’ils adoptent le regard des soldats israéliens, et non celui de leur gouvernement. Charges contre la guerre et son absurdité en général, ces films se gardent bien d’émettre des jugements politiques (ce qui leur a été reproché), se polarisent sur le traumatisme que cette campagne a provoqué dans des consciences. Il s’agit moins de films historiques que d’expériences individuelles, de mémoires intimes, de chocs psychiques générant des cauchemars privés.
John Ford retraçant l’encerclement d’un groupe de soldats n’a jamais omis de filmer l’espace environnant, l’horizon. Dans Lebanon, Samuel Maoz évacue toute profondeur de champ. L’ennemi est quasi invisible, remplacé par la notion prégnante d’un danger, sans échappatoire possible. Il y a enfermement, rétrécissement d’un groupe humain dans un espace exigu, sans extérieurs. Le cinéaste figure l’étouffement territorial de son pays par un tank où sont cloîtrés quatre soldats. Assaillants, mais en l’occurrence assaillis. Leur poste de guerriers est une prison.
Le parti pris est radical, métaphorique, fantastiquement physique. Hormis deux plans (le premier, le dernier, figeant le "décor" dans un champ de tournesols), tout Lebanon se situe à huis clos, dans ce char de combat, et tout ce que l’on peut percevoir au-dehors l’est par le prisme du viseur ou du périscope. Angle de vision étroit, sans perspectives à gauche ou à droite, concentré sur des cibles potentielles, des murs.
Nous sommes donc le 6 juin 1982, à 3 heures du matin, dans un tank aux ordres d’un officier communiquant par talkie-walkie, téléguidé vers une petite ville rayée de la carte ("Allez vérifier qu’il n’en reste rien"), enclin à tirer sur tout ce qui bouge, à abriter le cadavre d’un compatriote le temps qu’un hélicoptère vienne l’en débarrasser, sommé de violer le code international qui interdit l’usage des bombes au phosphore ("A la place de phosphore, on dira fumée ardente !"), de tirer sur des terroristes preneurs d’otages, de sortir de la zone sous contrôle syrien où le tank s’est malencontreusement aventuré.
Nous sommes aussi dans la tête de Samuel Maoz, qui fixe ses souvenirs, se remémore ses sensations, traduit la souffrance psychique des soldats. Au gré d’une caméra brinquebalée, filmant par à-coups, otage de toutes les obscurités, Lebanon montre un dehors irrationnel, imprévu, arbitraire, cynique, mortel, et un dedans où s’infiltre la panique, s’exacerbent les passions, se déclenchent les soifs, les larmes, les nausées, sueurs froides, envies de pisser.
Le son est capital dans ce défilé d’images infernales : un vacarme de ferraille, des crissements de carcasse, des bruits de balles, d’obus, de déflagrations, l’impact d’une roquette étrangère sur le métal qui sert de bouclier, et tout aussi effrayant, parfois, un silence, menaçant. "L’homme est d’acier, le tank n’est que ferraille", peut-on lire comme encouragement dans cette machine de fonte.
Tout le film s’acharne à prouver le contraire. L’homme est chair et sentiments. Lebanon peint l’épreuve initiatique, traque l’expérience humaine, la découverte de l’autre. Pas seulement entre enrôlés du même camp se défilant pour assurer un tour de garde ou accusant un tireur empoté de mettre la vie du groupe en péril. Lors d’une scène d’assaut, une femme libanaise sort hagarde de sa maison bombardée, cherche sa fillette tuée, se retrouve nue après que sa chemise de nuit s’est enflammée. Voyeurisme ? On peut retenir plutôt ce soldat qui lui tend un linge pour la couvrir, et ce plan où les yeux de cette femme fixent le viseur du tank, un regard-caméra qui accuse, qui renvoie l’observateur militaire à sa culpabilité, sa honte.
Pareillement, lors d’une autre scène où un phalangiste chrétien, allié des Israéliens, vient promettre à un prisonnier syrien les tortures les plus abominables, ce n’est pas le sadisme du milicien et le caractère douteux de ce renvoi de la cruauté sur les seules forces dirigées par Elie Hobeika qu’il faut voir, mais la terreur du condamné, sa crise de nerfs, l’empressement de ses geôliers israéliens à le calmer par la morphine. Lebanon ne vise pas la bonne conscience, mais la compassion.
Jean-Luc Douin
Article paru dans l’édition du 03.02.10