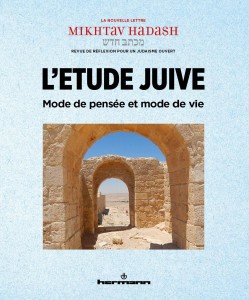En posant la question juif ou grec ? j’ai la certitude que cette dichotomie qui établit une frontière résonnera familièrement à nos oreilles. Tout un courant de pensée depuis le XIXème siècle nous y a habitués.
À l’heure des bilans, fin XXème siècle, notre collègue le philosophe français Rémi Brague, revenait dans son petit livre devenu désormais un classique, Europe la voie romaine (1996), sur les deux sources principales de l’Europe “Athènes et Jérusalem”, la “Voie romaine” représentant respectivement la secondarité d’une civilisation d’emprunt (Rome) dans deux domaines : le politique et le religieux. Passant en revue tous ceux qui avaient reconnu avant lui ces deux sources, Brague citait : Heine, David Luzzatto, Heinrich Graetz, Matthew Arnold pour le XIXème siècle et, pour le XXème siècle, Léon Chestov et Léo Strauss. Lors d’un colloque à la Fondation Calouste Gulbenkian (9-10 mai 1996) auquel il m’avait invitée à participer, je lui ai fait remarquer que tous ces auteurs étaient juifs, à l’exception de l’anglais Arnold qui ne dissimulait nullement sa dette envers Heine. Un autre de nos collègues, Yaacov Shavit,, dans un ouvrage proprement magistral, Athens in Jerusalem paru en hébreu en 1992 et en traduction anglaise en 1997, examine la bipolarité grec/juif qui a marqué les Juifs d’Europe au XIXème siècle et s’est naturellement étendue à la société israélienne au XXème*.Qui en Israël n’a appris le fameux poème de Saül Tchernikhovsky « Face à la statue d’Apollon »
C’est à Heine qu’il la fait remonter, ce poète tiraillé jusqu’à sa mort entre sa religion d’adoption et la religion de ses pères, auquel on doit cette déclaration catégorique « Alle Menschen sind entweder Juden oder Hellenen » (tous les hommes sont soit juifs soit hellènes) et qui espérait réconcilier en lui-même les deux âmes concurrentes qu’il ressentait en lui. Que l’âme juive l’ait tourmenté, nous pouvons le comprendre, mais pourquoi évoquer l’âme grecque plutôt que romaine ou mieux germaine à l’époque où s’impose en Allemagne la figure symbolique de Germania ?
Cette question a été également posée par Y.Shavit qui y a brillamment répondu par la grécomanie (ajoutons qu’il y eut aussi l’indomanie , voir Roger-Pol Droit : L’ oubli de l’Inde , une amnésie philosophique, PUF, Paris 1989) du romantisme allemand soucieux de se couper de toute racine “sémite”. Dans le cas de Heine, qui en réaction pensait l’union de l’“aryen” et du “sémite”, je voudrais proposer une autre explication : ce néophyte avait simplement lu le Nouveau Testament et notamment les écrits de Paul où le couple juif-grec est partout présent. Sans doute voulait-il reformer en lui un Chrétien des premiers temps : grec par la culture mais très proche encore de ses racines juives. Paul lui semblait avoir réalisé la symbiose des deux âmes. Je ne sais si Heine connaissait Philon car il aurait pu le dire de Philon aussi. La rédemption par la fusion de l’âme juive et de l’âme grecque, comme beaucoup de rêves d’avenir, n’était en fait qu’un rêve de retour vers le passé, un passé idéalisé. Or, dans ce passé, le Ier siècle, où vécurent Philon et Paul à une génération de distance, Grecs et Juifs n’étaient pas des entités imaginaires mais des catégories bien réelles qui se côtoyaient en permanence. Hellenismos et Ioudaismos pouvaient s’opposer comme au temps d’Antiochus IV Epiphane et de la révolte des Maccabées. Ils pouvaient aussi trouver diverses formes de modus vivendi, à différents niveaux. Toute vue d’ensemble serait une illusion. Seules les œuvres écrites qui nous sont parvenues nous permettent de pénétrer au cœur de la symbiose judéo-grecque : ces œuvres sont peu nombreuses mais étendues, ce sont précisément celles de Philon et de Paul, deux Juifs de la diaspora - ce n’est pas un hasard - écrites en grec. Pour essayer de cerner leur façon d’être au monde en réduisant les frontières entre “juif” et “grec”, nous comparerons successivement leurs origines, leur éducation et leur rapport à la Tora.
I - Les origines
Philon est d’Alexandrie et Paul de Tarse, en Asie Mineure. Chacun d’eux se réclame d’une ville de l’Orient hellénisé. Pour l’un, la grande cité d’Alexandre, si grecque qu’elle est à peine en terre égyptienne “apud Aegyptum”, en marge de l’Egypte. Pour l’autre, Tarse, capitale de la Cilicie sous domination romaine, elle aussi complètement hellénisée depuis trois siècles.
L’enracinement local de leur famille respective n’est sans doute pas aussi ancien pour l’un comme pour l’autre. Philon a à cœur de souligner l’antiquité de la présence juive dans sa cité dès sa fondation même, affirme-t-il (Flac. 46). Cela ne nous dit rien quant à l’installation de sa propre famille, mais tout ce que nous savons par ailleurs (grâce à Flavius Josèphe : AJ XX,100 ) nous la montre bien implantée, respectée et fortunée, certes très fidèle encore au judaïsme dans sa propre génération, mais déjà tentée par l’apostasie à la génération suivante comme le montre l’exemple de son neveu le préfet d’Egypte et général romain Tiberius Julius Alexander qui, aux côtés de Titus, devait faire le siège de Jérusalem en l’an 70. Comme les Grecs établis en Egypte, les Juifs, nous dit Philon, ont une ville-mère, une “métropole” dont ils se savent originaires, Jérusalem et une “patrie” « que le sort a donnée pour séjour à leurs pères, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères et leurs ancêtres plus lointains encore » (Flac. 46).
Sur les origines de Paul nous ne disposons que d’un bref passage autobiographique dans l’Epître aux Philippiens 3,5 : « Moi circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux, quant à la loi, pharisien ». Le lieu de sa naissance, Tarse, ne nous est pas connu par lui-même, mais par Luc dans les Actes des Apôtres : « Moi je suis juif, de Tarse en Cilicie, citoyen d’une ville qui n’est pas sans renom » (21.39). Encore cette indication est-elle mise en cause par Jérôme, selon qui Paul serait venu à Tarse tout jeune encore avec ses parents après que leur ville d’origine, Gischala en Galilée, eut été dévastée par les armées romaines. Il est difficile d’apprécier le crédit qu’il faut accorder à ce témoignage tardif, même si en amont de Jérôme il se rattache à Origène (III è siècle). Cela expliquerait que, selon Luc, Paul ait eu à Jérusalem un neveu et peut-être une sœur (Actes 23.16). Cela expliquerait plus difficilement comment une famille de réfugiés d’origine plutôt modeste ait pu accéder à la citoyenneté romaine revendiquée par Paul selon les Actes (23,27 ). En revanche, rien d‘étonnant à ce qu’elle ait été donnée à une famille de notables comme celle de Philon.
II - L’éducation
Bien que Philon ne nous fasse aucune confidence, il est aisé de mesurer à la lecture de son œuvre l’étendue de son éducation grecque. Il maîtrise à la perfection toutes les matières de l’enseignement général ou encyclios paideia, la grammaire (au sens d’étude des lettres), l’arithmétique, la musique, la rhétorique, auxquelles il se réfère souvent dans ses traités. Mais tout cela n’est à ses yeux qu’une propédeutique pour parvenir au savoir suprême qu’est la philosophie, de même que les nourritures lactées précèdent les nourritures solides chez l’enfant. En matière de philosophie, il semble avoir tout lu, tout médité depuis les présocratiques (Zénon, Anaxagore, Démocrite) jusqu’à la nouvelle Académie qui à ses yeux trahit le grand Platon. C’est indéniablement Platon qui l’inspire le plus, surtout dans son traité sur la Création où l’on sent l’influence du Timée. Pythagore, lui a aussi appris que tout est nombre. Les Stoïciens lui ont enseigné, outre la domination des passions, le principe de l’exégèse allégorique qui caractérise presque toute son œuvre. Il connaît bien aussi Aristote, même s’il ne lui donne pas son adhésion. Lequel de ses contemporains, grec ou romain, peut se prévaloir d’une culture philosophique aussi vaste ?
Philon participe en outre à la vie de la cité : non seulement il assiste à des conférences, mais il ne se prive ni de représentations théâtrales, ni de compétitions sportives, si l’on en juge par les fréquentes références qu’il y fait. L’éducation du corps n’est, nous dit-il, pas moins importante que celle de l’âme.
Voilà qui ferait de Philon un pur Grec s’il n’y avait aussi la Bible, une Bible qu’il connaît à merveille et ne se lasse pas de commenter, mais dans la langue grecque, à partir des termes grecs choisis par les Septante. Une opinion majoritaire lui attribue tout au plus une connaissance minime de l’hébreu. Peu importe, d’ailleurs, la langue d’origine, puisque Philon croit que le texte grec est lui-même inspiré. Selon lui, les traducteurs auraient « prophétisé comme si Dieu avait pris possession de leur âme (...) tous avec les mêmes mots et les mêmes tournures, chacun comme sous la dictée d’un invisible souffleur » (Vie de Moïse, II, 37). Comment mieux justifier l’étude de la Bible dans sa version grecque ?
La Bible grecque suffit à guider et structurer sa vie. Elle lui dicte sa nourriture quotidienne, son repos hebdomadaire, ses fêtes annuelles et occasionnellement ses pèlerinages dans la ville sainte.
En cela Philon est donc aussi juif, mais quand il lui arrive d’opposer des catégories au sein de l’humanité, c’est toujours la vieille dichotomie Grecs/Barbares qui revient sous sa plume. Lui-même se range indubitablement parmi les Grecs en vertu du principe largement admis qui avait permis l’émergence du monde hellénistique : est Grec quiconque est de langue grecque. En conséquence, il devait considérer comme Barbares des Juifs ne connaissant que peu ou pas du tout le grec.
Selon cette définition Paul est lui aussi un Grec. Sa maîtrise de la langue grecque est totale, même si - peut-être - par feinte humilité il rabaisse parfois son éloquence (II Cor. 10.10 et 11.6). On lui a attribué tout au plus deux possibles citations d’auteurs grecs mineurs (I Cor. 15.33 et Tite 1.12) qui supposeraient une étude de la “grammaire” mais il pourrait s’agir de dictons populaires. Rien n’indique en revanche qu’il ait accédé à la philosophie : son dialogue avec les philosophes épicuriens et stoïciens rencontrés à Athènes tourne court (Actes 17, 18). Là où, de l’avis général, Paul excelle, c’est la rhétorique, qu’elle soit discursive ou épistolaire ; il est passé maître dans le maniement du paradoxe. Sa jeunesse dans la ville de Tarse a nécessairement eu un impact sur son éducation. L’exercice corporel ne lui semble pas inconnu, il se réfère plusieurs fois aux jeux du stade et aime comparer sa mission à une course (I Cor. 9.24 ; II Tim. 2.5 et 4.7-8). Il est resté assez vigoureux à l’âge adulte pour nager un jour et une nuit après son naufrage (II Cor. 11.25).
Cependant quand il arrive à Paul de parler de lui-même, ce n’est pas Tarse mais Jérusalem qu’il présente comme sa ville nourricière, celle où il a reçu l’éducation qui compte pour lui, « aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères » (Actes 22.3). On n’en sait pas davantage, ni sur l’âge auquel il quitte sa ville, ni sur la durée de ses études auprès du plus grand maître pharisien de son temps. Si le jeune Saül put ainsi s’adapter à son nouveau cadre, c’est que par tradition familiale sans doute il connaissait déjà l’araméen et l’hébreu. Des expressions hébraïques se glissent dans ses épîtres en grec. Certains lui viennent de la Bible comme “la chair et le sang” (Gal. 1.16 ; I Cor. 15.50) pour souligner la faiblesse humaine, d’autres sont typiquement rabbiniques comme “ profaner le nom divin” (Rom. 2.24) que beaucoup ici présents comprendront mieux sous la forme hébraïque de hillul hashem ,encore si courante de nos jours dans les cercles pieux. Son discours à Antioche de Pisidie est typiquement un morceau de rhétorique juive fondée sur l’histoire biblique des Patriarches à Saül, et certains y ont même relevé des sémitismes. Et quand il dénonce l’immoralité liée au paganisme dans l’Epître aux Romains (1, 26-32), il va plus loin que le traité talmudique Avoda Zara., consacré aux rapports avec les idolâtres
La seule mention d’études à Jérusalem auprès du plus grand maître pharisien de son temps, Gamaliel le petit-fils du célèbre Hillel, appelé à fonder une longue dynastie, fait pencher Saül de Tarse du côté du judaïsme plus que de l’hellénisme. Philon, qui médite la Bible à Alexandrie dans la langue des philosophes grecs, apparaît infiniment plus Grec.
III - Le rapport à la Tora
Pour Paul, ainsi que pour Philon, la Tora est le Nomos, la Loi, conformément à une terminologie bien ancrée chez les Juifs hellénophones.
Ce choix à l’origine n’était pas dépourvu d’intentions apologétiques de la part des Juifs alexandrins. Il s’agissait de montrer que les Juifs avaient eu leur grand législateur, Moïse, comme les Athéniens leur Solon et les Spartiates leur Lycurgue.
Telle est encore bien l’intention avouée de Philon quand il écrit sa vie de Moïse pour un public païen, semble-t-il. Il y exalte ce personnage qui réunit toutes les qualités du chef idéal, a été aimé de Dieu “comme peu d’hommes” (Mos. II, 67) et demeure “le législateur” (nomothéthès) par excellence. Seules les “dix paroles” ont été révélées par Dieu lui-même au Sinaï ; elles constituent un corpus de lois fondamentales d’où dérivent toutes les autres lois bibliques transmises par Moïse. Son goût pour l’allégorie n’amène pas Philon à minimiser l’observance de ces lois. Il ne se pose pas en penseur dédaigneux du rite, sous couvert d’explications philosophiques. Négliger “le contenu visible” risquerait de développer un individualisme préjudiciable à la vie de la communauté. À chercher « la vérité pour son propre compte, on ne connaîtrait plus ni cité, ni bourg, ni maison, ni finalement aucun groupe humain » (Migr. 90). Les pratiques du judaïsme ont été déterminées par des personnages inspirés supérieurs à nos contemporains. Si elles rencontrent encore doutes ou incompréhension parmi les Juifs eux-mêmes, Philon estime de son devoir de les justifier en y mettant son cœur et son intelligence. De son point de vue, elles ne constituent pas des barrières qui séparent mais l’application d’une loi universelle où tous pourraient se retrouver.
On ne saurait reprendre ici tous les points qu’il aborde dans son traité sur les Lois spéciales (c’est-à-dire détaillées). Il est significatif qu’il y affronte d’emblée la question la plus controversée de son temps, celle qui, témoigne-t-il, est « l’objet des railleries de la foule » (Spec. I, 1) : la circoncision. Bien qu’il ne soit pas spécifique aux Juifs, cet usage était vu comme un marqueur identitaire propre à eux si l’on en juge par les échos des plaisanteries grossières préservées dans la littérature latine du Ier siècle. Philon y répond par des explications d’ordres divers : médical (prévention de maladies génitales des pays chauds, meilleure fécondité), rituel (pureté sacerdotale comparable à la pratique des prêtres égyptiens) et symbolique (notion biblique de “circoncision du cœur”, Deutéronome 10.16). Notons qu’il fait dans tous ces cas appel à la raison et ne se réfère jamais à la notion d’alliance difficile à expliquer rationnellement et susceptible d’entraîner l’accusation de particularisme. Il ajoute que la valeur symbolique ne doit pas conduire à négliger la pratique, car il y a dans la loi deux aspects correspondant « l’un au corps, l’autre à l’âme et donc comme il faut songer au corps parce qu’il est la maison de l’âme, il faut pareillement se soucier des lois telles qu’elles sont énoncées » (Migr. 93).
Philon apporte une réponse analogue en ce qui concerne les préceptes alimentaires. Ces lois de pureté qui empêchaient la convivialité des Juifs et des païens étaient sans doute celles qui créaient les frontières les plus tangibles au quotidien ; elles avaient donné lieu à la grave accusation de misanthropia (haine du genre humain). Philon combine les justifications hygiéniques, morales, symboliques. En définitive, il s’agit surtout d’inviter à la maîtrise des passions et au contrôle de soi : « c’est à ce prix qu’on devient un homme accompli » (Agric. 131).
Quant à l’observance du shabbat qui pouvait irriter certains païens mais attirait aussi des prosélytes, Philon n’en fait jamais le signe d’alliance entre Dieu et son peuple et ne le relie jamais à l’esclavage en Egypte comme en Deut.5,15 : le chiffre sept, dit-il, le fait participer de la nature divine, il nous invite à l’imitatio Dei, nous fait vivre en harmonie avec le monde créé. L’absence de toute activité tournée vers le profit favorise une disponibilité d’esprit propice à régénérer la réflexion et à s’élever vers Dieu. Chacun peut ainsi avoir accès à la vie contemplative, la vie de l’âme.
Philon retrouve le chiffre sept dans toutes les fêtes bibliques : Pâque, Pentecôte, les célébrations du septième mois (Tishri ), qui toutes reçoivent également des explications allégoriques d’ordre cosmique. C’est le cosmos qu’il découvre encore dans le vêtement cérémoniel du grand-prêtre dont les couleurs représentent les quatre éléments de la nature, ce qui permet à Philon d’affirmer que « le grand-prêtre des Juifs offre ses prières et ses sacrifices d’action de grâce, non seulement à l’intention de tout le genre humain mais de l’univers entier » (Spec. I, 97). Il le fait certes par nécessité dans un Temple localement bien défini, mais « le vrai Temple de Dieu » est « le monde tout entier ; il a pour sanctuaire la partie la plus pure de l’essence des choses, le ciel, pour offrandes votives les astres, et pour prêtres les anges » (Spec. I, 66).
Cet universalisme non seulement humain mais cosmique de la Loi s’explique par la convergence entre le Logos qui anime le monde et celui qui passe dans la Parole sacrée transmise à Moïse. En d’autres termes, la Loi de Moïse est Logos comme l’est la Loi de nature. Il ne s’agit pas de simples coutumes nationales fondées sur l’opinion à l’instar des lois des autres peuples mais « le monde est en accord avec la Loi et la Loi avec le monde » de sorte que « l’homme soumis à la Loi est par là-même citoyen du monde, puisqu’il conforme ses actions à la volonté de nature, sur laquelle se règle aussi l’administration de l’univers » (Opif. 3). Chacun peut à son tour rejoindre l’harmonie universelle en accord avec le système de la nature éternelle et devenir un citoyen du monde par l’obéissance à la Loi. Seule la situation politique peu brillante des Juifs empêche la diffusion d’une Loi aussi auguste, mais Philon garde confiance : « Lorsque l’éclat de nos lois s’accompagnera de la prospérité de notre nation, elles feront rentrer les autres dans l’ombre comme fait le soleil levant pour les étoiles » (Mos. II, 44).
En définitive, on le voit, l’essentiel de l’œuvre de Philon constitue une apologie de la Loi. En celle-ci se retrouvent certes des idées qui ont pu visiter tel ou tel philosophe grec - peut-être même après avoir pris connaissance de la doctrine de Moïse qui, pour un Juif alexandrin, était nécessairement antérieure à la philosophie (c’est le thème repris par les Pères de l’Eglise, du “larcin des philosophes”), mais la Loi va bien au-delà. Non seulement l’étude de la Loi permet de retrouver le meilleur de la philosophie mais, au lieu de rester sur le plan purement intellectuel, elle offre une élévation spirituelle à l’image de celle des patriarches, vraies “lois vivantes”. Par elle, il est donc permis à chacun de devenir Israël, c’est-à-dire, selon l’étymologie philonienne « celui qui voit Dieu ».
Philon a voulu faire tomber les barrières entre le Juif et le Grec en montrant que leurs deux mondes communiquaient entre eux par l’intermédiaire d’une Tora en langue grecque et d’une philosophie grecque qu’il suffisait de savoir retrouver dans la Bible. Les Juifs hellénophones vivaient déjà en milieu grec, il s’agissait maintenant d’attirer les Grecs vers la Loi de Moïse. L’existence de prosélytes pour lesquels Philon n’a pas assez d’éloges l’encourageait dans cette espérance. Toutefois son message ne pouvait s’adresser qu’à une élite intellectuelle formée à la philosophie et déjà favorablement disposée.
Philon reste un contemplatif, même si la pression des événements l’a obligé à l’action vers la fin de sa vie, lors de l’ambassade à Caligula. Tout au contraire, Paul, cet autre Juif de la diaspora du Ier siècle, est dès sa jeunesse un homme d’action.
Le rapport à la Loi est au cœur de la pensée paulinienne. Il a longtemps été abordé par les théologiens d’une manière simpliste. Ainsi la conversion de Paul était traditionnellement interprétée par la critique protestante allemande comme une rupture avec le judaïsme sous l’influence de l’hellénisme : il aurait tout simplement franchi la frontière et serait passé de l’autre côté. On reconnaît là l’influence de la pensée du XIXème siècle qui voulait “désémitiser” le christianisme. Les études de théologiens chrétiens contemporains, celles de J. Dunn en Grande Bretagne ( et de l’équipe des participants aux colloques organisés sous sa responsabilité) , de E.P. Sanders aux Etats-Unis, de Peter Tomson en Belgique font apparaître une situation infiniment plus complexe où il est parfois fort difficile de se retrouver.
Paul est-il un contempteur de la Loi ? Un chapitre de sa plus célèbre épître (Romains 2) prouve exactement le contraire, c’est sans doute pour cela qu’il a été si négligé par les commentateurs traditionnels. Paul y invite justement à ne pas enfreindre les préceptes de la Tora : « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la Loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés » (Rom. 2.13). Tout ce chapitre est une prédication morale en vue d’un comportement qui mette en accord les paroles et les actes de qui se prétend pieux (2.17.24), faire le contraire de ce que l’on prône c’est blasphémer. Un prédicateur ultra orthodoxe de nos jours ne dirait pas mieux en dénonçant le hilloul hashem. Sanders y a reconnu « an old synagogue sermon with minimal christian updating ». La circoncision n’y est pas mise en cause, elle constitue un engagement à respecter la Loi, à intérioriser ce respect par la « circoncision du cœur » (2.39), une notion reprise du Deutéronome et, on l’a vu, familière aussi à Philon.
La thèse de P. Tomson, auteur d’un important ouvrage sur la halakha ( !) de Paul, est que « Paul le chrétien » n’a pas renié mais a, d’une certaine façon, réintégré son passé juif : n’affirme-t-il pas qu’aux « Israélites » continuent d’appartenir « l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses » (Rom. 9.4), car les dons de Dieu sont irrévocables ? Paul, tout en substituant la foi à la Loi (nous y reviendrons), est lui-même resté dans le judaïsme, un judaïsme alors profondément divisé en courants divers où Jésus et ses disciples trouvaient une place quelque part entre Pharisiens et Esséniens. Certes Paul martèle sans cesse la doctrine de la justification par la foi, mais il est aussi un esprit pratique. Ses disciples ont eux-mêmes des questions pratiques à lui soumettre et il leur répond dans ce que l’on peut considérer comme une sorte de responsum rabbinique (I Corinthiens 7 et 8) : se marier pour éviter la débauche et ne pas se quitter - sauf pour la prière - afin d’éviter les tentations, mais préférer le célibat si possible, ne pas divorcer, même si le conjoint est non-croyant, rester incirconcis si on l’est « car la circoncision n’est rien et l’incirconcision n’est rien, mais l’observance des commandements est tout » (I Cor. 7.19), de préférence ne pas se remarier pour une veuve, se couvrir la tête pour une femme (Cor. 11.10), manger de tout, même des viandes sacrifiées aux idoles car celles-ci ne représentent rien, mais se méfier des apparences trompeuses que l’on peut offrir aux plus faibles (c’est le principe rabbinique de mar‘it ‘ayin) : « Si un aliment scandalise mon frère je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère » (I Cor. 8.13).
Si le terme de halakha a pu paraître quelque peu provocateur appliqué à Paul, il n’en demeure pas moins que l’apôtre cherche à établir des règles de conduite. Quand l’accueil mitigé fait à sa prédication dans les synagogues d’Asie Mineure et de Grèce l’amène à devenir l’apôtre des païens, il lève les obstacles devant les candidats à la conversion. Selon la formule de Sanders, « the Law is not an entrance requirement ». En tant que Juif de la diaspora, Paul connaît aussi bien que Philon ce qui fait difficulté aux Gentils et risque de les repousser : la circoncision et les lois alimentaires. Il est prêt à abaisser ces barrières pour eux, sans nullement obliger les judéo-chrétiens à renoncer à des pratiques ancestrales. De là sa hargne envers les faux-frères, ces autres missionnaires qui veulent imposer la circoncision aux Galates. Il met en garde ceux-ci : être circoncis c’est se placer sous le joug de la Loi et s’obliger à l’observer tout entière (Gal. 5. 2-3). (De nos jours c’est encore l’avertissement que lancent les rabbins orthodoxes aux candidats à la conversion pour éprouver leur détermination). Lui-même semble avoir hésité entre deux attitudes : à Timothée, fils d’un Grec et d’une juive, il impose la circoncision, mais il en dispense Tite qui était Grec (Gal. 3.2). Quant aux règles alimentaires, à l’observance des fêtes, que chacun fasse comme il l’entend : « Tel croit pouvoir manger de tout » (Rom. 14.2), « Tel fait une distinction entre les jours » (ibid. 5), l’essentiel étant de ne pas mépriser celui qui n’agit pas comme soi. Paul propose son propre modèle : Juif avec les juifs, comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, faible avec les faibles, « tout à tous afin d’en sauver quelques-uns » (I Cor. 9-20.22).
Par certains aspects, Paul semble ainsi avoir préfiguré le judaïsme laïque ou réformé de nos jours qui reste fidèle à un certain patrimoine culturel sans s’imposer « le joug des commandements ». Cette vision superficielle d’une sorte de judaïsme “allégé” à l’usage des païens méconnaîtrait toute la théologie paulinienne.
Au temps de Paul, malgré l’existence de divers courants à l’intérieur même du judaïsme, la pratique était prise au sérieux par tous. Ainsi, ne pas observer les lois alimentaires et le marquer publiquement était une manière d’apostasie, comme le montre le livre II des Maccabées. Au contraire, se mettre à observer le sabbat était une façon de judaïser, ce que dénoncent plusieurs auteurs romains du Ier siècle. Paul, qui se sent investi d’une mission auprès des païens, veut les convertir à autre chose que le judaïsme, marqué par l’observance de la Loi. Un de ses arguments à l’endroit des craignants-Dieu qui auraient pu être attirés par une partie de cette observance, est que celui qui se soumet à la Loi s’expose au péché car nul ne peut accomplir toute la Loi « La Loi produit la colère et là où il n’y a plus de loi il n’y a point non plus de transgression » (Rom. 4.15). En supprimant l’obéissance à la Loi, Paul propose de délivrer l’homme du péché. Ce faisant, il fait aussi disparaître un marqueur identitaire : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec » (Gal. 3.28).
Cette phrase si souvent citée à l’appui de l’universalisme paulinien n’est pas toujours comprise faute d’être lue jusqu’au bout "car tous vous êtes un en Jésus-Christ", et d’être replacée dans la doctrine centrale de Paul : celle de la justification par la foi.
C’est en effet par l’accent mis sur la foi plutôt que les œuvres que Paul innove radicalement : quiconque croit est sauvé. Croire c’est croire en Jésus-Christos (Messie), mort pour nous (Rom. 5). La Loi ne peut affranchir du péché et de la mort, la foi libère de la Loi donc du péché (Rom. 6.13) et offre la vie et la grâce (Rom. 6.15-17).
Par cette doctrine Paul est-il juif ou grec ? ni l’un ni l’autre sans doute. On a certes pu tenter d’établir un lien avec le courant apocalyptique juif encore très vivant de son temps, mais nulle part ne se trouve l’idée du rachat des péchés de tous les hommes par le sacrifice d’un seul homme. Albert Schweitzer, qui était aussi un grand exégète, a sans doute néanmoins eu raison de le rattacher au sentiment d’imminence de la fin des temps qui caractérise la période.La fin des temps toute proche rendait urgente la recherche du salut que Paul souhaitait mettre à la portée du plus d’hommes possible, et que l’apprentissage de la Loi ne pouvait que retarder.
° °
°
Quelle conclusion nous inspire ce parallèle entre deux illustres juifs de la diaspora confrontés à une prestigieuse civilisation différente de leur tradition religieuse ?
Philon a effacé dans sa propre pensée les frontières entre juif et grec : il est à la fois l’un et l’autre, mais il reste un ardent adepte de la Loi dans sa communauté dont il est une figure importante. Les Juifs qu’il connaît sont déjà largement grecs, il rêve que les Grecs comprennent aussi à quel point ils sont proches du judaïsme. Mais cela ne peut se faire qu’au niveau le plus élevé de la réflexion philosophique et son message reste donc très élitiste.
Paul est beaucoup plus juif que grec par sa culture. Même ce que l’on a appelé son "antinomisme" ne le détache pas vraiment du judaïsme car il revient à dire que l’observance de la Loi n’est pas un préalable nécessaire pour qui veut gagner le salut. Paul abaisse ainsi des frontières, mais il s’en dresse d’autres pour ceux, Juifs ou Grecs, qui ne le suivent pas. La rupture se situe dans sa doctrine de la foi en ce "dieu inconnu" qu’il essaie vainement de faire découvrir aux Athéniens. Par là il n’est "ni juif ni grec", tout en étant à la fois l’un et l’autre..
En tout état de cause, seule la diaspora de culture grecque pouvait produire de tels essais de synthèse car elle était le lieu même de la rencontre entre Juifs et Hellènes.
Mireille Hadas-Lebel