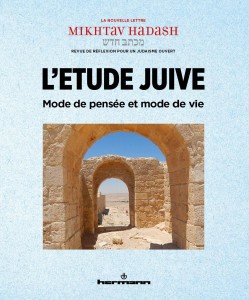J’aime le cinéma de Suleiman parce qu’il échappe au manichéisme et parvient à parler avec humour de l’impasse dans laquelle se sont retrouvés les palestiniens sans accuser personne, mais en regardant les différentes facettes de la réalité avec lucidité et humour.
Certains lui en ont même voulut pour cela et l’ont même traité de "collabo"... Pourtant, il n’est pas tendre avec Israël et sait montrer les points douloureux avec intelligence.
Il me semble important pour le public juif de connaître son oeuvre cinématographique et de s’ouvrir à une réalité, celle des arabes israéliens, qui fait bien parti de notre réalité et avec qui nous avons tant à partager.
Yeshaya Dalsace
Propos du cinéaste
Voici comment Suleiman raconte son film :
Le Temps qu’il reste est un film en partie autobiographique, construit en quatre épisodes marquants de la vie d’une famille, ma famille, de 1948 au temps récent.
Ce film est inspiré des carnets personnels de mon père, et commence lorsque celui-ci était un combattant résistant en 1948, et aussi des lettres de ma mère aux membres de sa famille qui furent forcés de quitter le pays.
Mêlant mes souvenirs intimes d’eux et avec eux, le film dresse le portrait de la vie quotidienne de ces palestiniens qui sont restés sur leurs terres natales et ont été étiquetés "Arabes-Israéliens", vivant comme une minorité dans leur propre pays.
Fiche technique
Réalisé par Elia Suleiman
Avec Saleh Bakri, Yasmine Haj, Leila Muammar,
Durée : 01h45min Année de production : 2009
Critique du Monde
"Le temps qu’il reste" : Etre drôle et facétieux sur fond de tristesse infinie
Où suis-je ?", panique un chauffeur de taxi sous un orage de fin du monde, champ de vision bouché en sortie d’aéroport, contraint de s’arrêter sur le bord de la route. A l’arrière du véhicule, Elia Suleiman reste muet, perplexe sur ses chances de rentrer "à la maison".
Né en 1960 à Nazareth, de parents arabes devenus subitement citoyens israéliens en 1949 après les accords d’armistice entre Israël et Palestiniens, Elia Suleiman est parti s’installer, à l’âge de 21 ans, à New York, dans le malaise de l’exil. Il s’est inventé un personnage de clown dépressif depuis son deuxième court métrage, Hommage par assassinat, en 1991. Ce désarroi, inscrit dès le prologue du Temps qu’il reste, est son électrocardiogramme de nomade depuis qu’il ne cesse de revenir sur les lieux de son enfance, lorsqu’il n’est pas à Paris ou au Liban.
Conçu à partir des carnets personnels du père du cinéaste et des lettres que sa mère envoyait aux membres de la famille expatriés, le film évoque la tragédie palestinienne à travers la chronique intime du clan Suleiman. Faits de résistance du père en 1948, surveillance permanente des militaires israéliens, mariage, naissance d’Elia Suleiman. La rébellion se manifeste en sourdine lorsque l’enfant paraît.
C’est là qu’en écho de cette rage qui doit se contenir pour ne pas éveiller les soupçons de ceux qu’il considère comme occupants, que Suleiman déploie ce style qui l’a révélé : une suite de saynètes au burlesque subversif, où l’oppression est montrée sur un mode comique et où la violence reste tapie au fond des coeurs. La performance est là : de signer un film drôle et facétieux sur un fond de tristesse infinie.
Le Temps qu’il reste cultive une forme d’insurrection par l’esprit, entendez cette façon d’avoir de l’humour avec mauvaise humeur. Choc sentimentalo-politique à l’annonce de la mort de Nasser, insurrection permanente à l’école où une chorale obtient le prix de la chanson hébraïque, et où Elia, gamin, se fait réprimander par son prof pour avoir parlé d’Amérique impérialiste. Extrait du Spartacus, de Stanley Kubrick, qui souligne le désir de révolte des exclus de l’Histoire. Ironie du sort des hommes arbitrairement opposés : après avoir sauvé un soldat israélien d’une explosion, le père d’Elia est hospitalisé à côté de lui, mais séparé par un rideau... Scène qui annonce celle du rêve où Elia saute à la perche par-dessus le mur séparant Israël et les "territoires".
Dans cette fusion de l’épique et de l’intime, l’essentiel tourne autour des questions de voisinage, avec ce gag récurrent du type habitant la maison d’à côté et qui s’asperge d’essence pour s’immoler. Et ces vignettes ironiques : celle où le gamin jette rituellement à la poubelle l’assiette de lentilles préparées par la tante qui loge deux maisons plus loin ; celle des soldats n’osant pas interdire une boum illégalement orchestrée après le couvre-feu, et qui se mettent à danser dans leur véhicule au son de la techno arabe.
La musique est t-elle susceptible d’adoucir les moeurs ? L’un des plans les plus touchants est celui, dans la troisième partie, où Elia Suleiman retrouve une vieille mère absente, murée dans le silence, figée dans ses souvenirs, et où son petit bonheur est de la voir balancer légèrement le pied quand il passe une chanson ancienne sur le tourne-disque.
Elia Suleiman désigne aussi la cuisine comme espace de réconciliation, lieu où s’agglutine la famille, lieu où s’activent une femme de ménage philippine et un soldat israélien en cohabitation, autour de la mère veuve, qui (pulsion régressive) se relève la nuit pour se goinfrer de glaces.
On n’est pas surpris de relever chez ce Buster Keaton oriental un goût immodéré des silences, parce que le silence est à la fois une arme (une inquiétante manifestation de désapprobation), un moment de partage (le film traque les instants où les ennemis se trouvent un langage commun, le silence en est un). On est saisi par ce qu’exhume de souffrance cet échange de répliques entre un soldat israélien et un Palestinien : "Rentre chez toi ! - Toi, rentre chez toi !"
Le clown désenchanté sait se taire, mais sait aussi parler. Le "Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?" du prologue résonne comme une allusion caustique à la parole du Christ en croix. Mais ses images les plus percutantes sont pures gestuelles, déplacements d’objets et de corps dans le cadre. Par exemple, ce plan à la fois comique et terrifiant où un Arabe arpente une rue, offrant le spectacle d’un va-et-vient bavard d’un trottoir à l’autre en parlant sur un téléphone portable, et où chacun de ses mouvements est suivi par un tank israélien, à quelques mètres, comme un canon braqué sur un insecte.
Jean-Luc Douin