Synopsis :
Le quartier d’Ajami, à Jaffa, est un lieu cosmopolite où cohabitent Juifs, Musulmans et Chrétiens. Le jeune Nasri, âgé de 13 ans, et son grand frère Omar vivent dans la peur depuis que leur oncle a tiré sur un membre important d’un autre clan. Malek, un jeune réfugié palestinien, travaille illégalement en Israël pour financer l’opération que sa mère doit subir. Binj, palestinien, rêve d’un futur agréable avec sa petite amie chrétienne. Dando, un policier juif recherche désespérément son jeune frère disparu... L’histoire de destins croisés au coeur d’une ville déchirée.
La régularité métronomique avec laquelle s’enrichit ce jeune cinéma d’auteur est décidément impressionnante.
Dans cet éventail, les coréalisateurs Scandar Copti et Yaron Shani introduisent avec Ajami deux éléments inédits. D’abord, la nature de leur collaboration, qui associe, pour ce premier long métrage, un Israélien d’origine juive à un Israélien d’origine palestinienne, ce qui n’est pas rien par les temps qui courent. Ensuite, le choix assez audacieux de réaliser un polar, genre laissé en friche par un cinéma auquel le cours ordinaire de la société israélienne donne déjà de l’hypertension. Réunis, ces deux éléments produisent un film électrique, nerveux, inventif, palpitant comme la vie, tranchant comme la mort.
L’action se situe à Jaffa, accessoirement ville des oranges, plus essentiellement cité historique rattachée à l’agglomération de Tel-Aviv depuis 1950, après que la guerre de 1948 en eut vidé la majeure partie de la population palestinienne. Le quartier d’Ajami, qui donne son nom au film, conserve la trace de cette hétérogénéité.
La cohabitation judéo-arabe s’y trouve empoisonnée par un conflit qui n’en finit plus, infectée par des haines sourdes et recuites. Le cadre est idéal pour un film noir. Trois histoires s’y déroulent, s’y entremêlent et s’y dénouent sous le signe de la tragédie.
Chacune porte un enjeu différent autour d’un personnage central. Omar, jeune Israélien d’origine palestinienne, doit avant tout sauver sa peau, après que son oncle eut blessé un membre d’une puissante tribu bédouine spécialisée dans le racket. Non contente d’avoir éliminé l’oncle, celle-ci veut à présent verser le sang du neveu. Aux abois, ce jeune orphelin de père fait appel à la médiation de son employeur, Abu Elias, un restaurateur respecté, notable chrétien de la communauté palestinienne dont il fréquente secrètement la fille, charmante brune emmurée par la loi patriarcale.
Malek, adolescent palestinien de Cisjordanie et ami d’Omar, jouit également de la protection d’Abu Elias, chez lequel il travaille comme grouillot, tandis que sa mère, hospitalisée en Israël, lutte contre une maladie mortelle. Dando, enfin, est un inspecteur de police du quartier, obsédé par la disparition de son frère, un jeune conscrit assassiné par des Palestiniens au retour d’une période militaire.
Là-dessus, il faut avouer l’impuissance des mots à restituer la virtuosité avec laquelle le film file cet écheveau. Tout juste peut-on préciser qu’on y trouve une multitude de personnages secondaires superbement campés, des allers-retours d’une redoutable efficacité dans la chronologie narrative, un gros paquet de drogue qui circule comme la fatalité s’abat sur le monde, des assassinats ciblés, une vengeance qui se trompe d’objet, une abjecte trahison, tout cela produisant de la tension, de l’émotion et de la complexité à revendre.
Ce tableau évoque, en dépit de la grandeur conférée aux personnages, un monde pourri de l’intérieur par les logiques claniques, vitrifié par le repli communautaire, mû par une incontrôlable puissance mortifère.
Cet impact tient pour l’essentiel à deux facteurs. L’influence esthétique des meilleures séries télévisées américaines (type "Les Soprano", "Sur écoute" ou "Breaking Bad"), où la trivialité des personnages le dispute à la sophistication de la forme. Mais aussi une approche de type documentaire, qui associe des acteurs non professionnels, non avertis du scénario, à un tournage chronologique privilégiant les prises uniques.
Ces partis pris produisent, dans un film pourtant très stylisé, un effet de réalisme et de prise sur le vif impressionnant. Comme l’a récemment prouvé Un prophète, de Jacques Audiard, lorsqu’un film de genre parvient à intégrer aussi intelligemment dans ses gènes le contexte sociopolitique qui le sous-tend, cette oeuvre a alors toutes les chances d’être exceptionnelle.
Jacques Mandelbaum (Le Monde du 07.04.10)
Fiche technique
Film israélien de Scandar Copti et Yaron Shani. Avec Shahir Kabaha, Ibrahim Frege, Fouad Habash. (1 h 58.)
Conflit à Holywood
Le réalisateur arabe du film "Ajami" refuse de "représenter Israël"
Le co-réalisateur arabe du film israélien "Ajami", nominé aux Oscars, a déclenché une vague d’indignation en Israël en affirmant qu’il refusait de se considérer comme un représentant de l’Etat hébreu lors de la cérémonie de remise des Oscars à Hollywood.
"Je ne suis pas l’équipe israélienne et je ne représente pas Israël", a déclaré dimanche Scandar Copti dans une interview à la télévision israélienne.
"Je ne peux pas représenter un pays qui ne me représente pas", a insisté M. Copti, provoquant un tollé dans la classe politique.
Son film, qu’il a co-réalisé avec un metteur en scène juif, Yaron Shani, fut candidat à l’Oscar du meilleur film étranger.
Scandar Copti est membre de la communauté arabe israélienne qui compte 1,5 million de descendants des Palestiniens restés sur place après la création de l’Etat hébreu en 1948. La loi définit des droits égaux entre Juifs et Arabes, mais nombre de ces derniers reprochent aux autorités israéliennes de pratiquer une discrimination envers leur communauté.
"Ajami" raconte le quotidien d’Arabes et de Juifs dans le quartier de Jaffa, au sud de Tel-Aviv, divisés par leurs allégeances, claniques, religieuses ou ethniques, et que le destin plonge dans l’univers violent de la pègre locale.
Le ministre des Sciences et des technologies, Daniel Hershkowitz, du parti national-religieux "Foyer Juif", a vivement critiqué M. Copti, l’accusant de cracher sur Israël en même temps qu’il a reçu un financement public israélien pour tourner son film.
"Celui qui a réalisé ce film avec des fonds de l’Etat d’Israël devrait se couvrir du drapeau du (mouvement palestinien) Hamas ce soir. Un Oscar pour Ajami serait une victoire à la Pyrrhus pour l’Etat d’Israël", a-t-il dit, cité par le site d’information israélien Ynet.
De son côté, la ministre de la Culture, Limor Livnat, a rappelé que le réalisateur devait sa présence à Hollywood uniquement grâce aux fonds publics israéliens.
"Sans le support financier de l’Etat d’Israël, Copti ne se tiendrait pas dimanche soir sur le tapis rouge", a-t-elle estimé dans un communiqué.








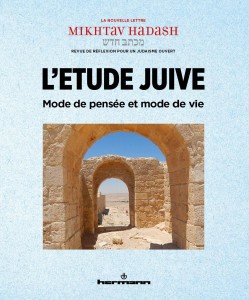


Messages
Il a l’air bien ce film. Il a eu raison l’autre de pas représenter un pays qui donne de l’argent pour qu’un film soit à Hollywood mais pas pour que ses habitants aient de quoi manger.
Je viens de visionner à l’instant et pour la seconde fois Ajami. Il est vrai que plusieurs histoires se trouvent imbriquées l’une dans l’autre et c’est je pense, justement, cet enchevêtrement qui contribue à donner de l’intensité, de l’étoffe à ce film.
Je ne rentrerai pas dans la polémique du politiquement correct à savoir si le réalisateur arabe avait eu tort ou raison de ne pas prétendre à un oscar pourtant, je ne peux que constater le tour de force d’une telle coréalisation.
Pas moins de 7 ans de fabrication et des kilomètres de bandes avec des acteurs pour la plupart novices ne découvrant leur scénario qu’au dernier moment. Résultat : un film poignant et empreint de réalisme. Une tâche de cette ampleur ne peut que forcer au respect.
(Entretien avec Scandar Copti et Yaron Shani :
http://www.cinemovies.fr/fiche_info…)
Et puis la musique choisie pour le générique de fin, qui semble venir d’un autre âge, me laisse dans un certain état d’apesanteur, un peu comme dans les dernières paroles des dernières images : « tu fermes les yeux, tu comptes jusqu’à 3 et tu te réveilles dans un autre monde »…
(http://www.youtube.com/watch?v=qbP1…)
En tout cas Ajami c’est 2 heures à retenir son souffle…