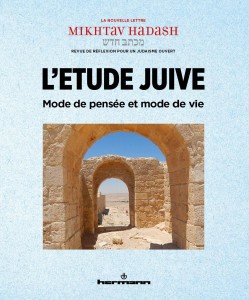C’est donc, ce soir, le commencement du jour du grand pardon. Nous commençons ce jour, comme tous les autres d’ailleurs, par la nuit, ce qui est aussi un enseignement qu’il convient de méditer : le jour émerge de la nuit qui, depuis la Genèse, en porte la promesse. Nul ne peut jouir de la clarté du jour sans traverser la nuit, avec confiance, malgré les souffrances qui, trop souvent, la font ressembler aux ténèbres et en dépit des nombreuses associations négatives que les hommes font peser sur la nuit. N’est-elle pas considérée comme le symbole de l’ignorance et des préjugés par ceux qui célèbrent les Lumières, comme celui du péché et du deuil, par ceux qui ne perçoivent plus la moindre lueur d’espoir ?
Mais, précisément, la Torah enseigne à voir en elle, dans son obscurité, la promesse du jour. Dès lors, même quand il nous semble être dans une nuit sans issue - pour ce soir, ce sera celle du péché, celui que nous faisons, celui que nous subissons - il s’agit pour nous d’espérer encore l’issue du jour, en l’occurrence celui du pardon - celui que nous recevons, celui que nous accordons - et c’est ce que je voudrais méditer avec vous.
La dernière Michna du Traité talmudique Yoma (85b) enseigne que Yom Kippour a la force propre de « recouvrir » (mékapper) les fautes commises par un homme à l’égard de Dieu (laMaqom) tandis qu’il n’en est pas ainsi pour celles commises à l’égard de son prochain (lahavero). Yom Kippour n’a pas la force propre de « recouvrir » ces fautes là sauf si, au préalable, ce prochain y consent (iératsé).
Il semble donc, à méditer cette Michna , que le jeûne et les prières de Yom Kippour, les demandes de pardon qu’on y expose et les engagements qu’on y prend, dans notre solitude et dans notre proximité à toute la communauté d’Israël, soient suffisants pour réduire la distance qui nous sépare de Dieu. C’est en effet là le sens des fautes à Son égard, elles accroissent et approfondissent cette distance, au point même que, parfois, on en perd la conscience, ce qui, évidemment, est le pire. La repentance (techouva) manifeste notre désir de nous rapprocher de Lui (de retourner à Lui). Dès lors, si on peut compter comme faute à l’égard de Dieu, l’oubli de la Torah et du Chabbat, le culte de l’argent (mammon) ou d’autres idoles, mais aussi le sentiment de désespoir qui monte en nous parfois face aux tragédies de l’histoire et à nos souffrances propres quand elles semblent sans issue, il suffit (si je puis dire) de nous présenter devant le Créateur dans notre nudité profonde, jusqu’à l’oubli de notre « moi » comme disent les Hassidim, pour que ces fautes là soient recouvertes par le pardon de Dieu. Yom Kippour nous redonne confiance, après la nuit, vient l’aurore, et cette nuit même prépare cette aurore. Le rite participe à cette prise de conscience, à ce renouveau de l’espoir. Le rite, écrit Emmanuel Levinas, « n’est pas du tout extérieur à la conscience, il la conditionne, il lui permet d’entrer en elle-même et de se tenir éveillée ».
Pourtant cette Michna , nous dit que cela ne suffit pas : on pourrait se croire quitte à bon compte dans un tête à tête avec le Créateur. On pourrait croire qu’Il suffit d’être sûr qu’Il nous aime et que le reste est sans importance.
La Michna affirme que la distance qui nous sépare de Dieu demeure tant que notre prochain n’est pas apaisé. Elle semble donc prêter à ce prochain un pouvoir que Dieu Lui-même n’a pas : Dieu ne peut en effet pas nous pardonner la faute que nous avons commise envers ce prochain si celui-ci refuse de nous pardonner : si cette faute n’est pas « recouverte » par lui, c’est-à-dire si lui, le prochain, continue de la percevoir, et ne veut pas cesser de la percevoir. Or tant qu’il ne le veut pas, c’est aussi la distance qui nous sépare de Dieu qui se creuse, profonde et troublante, jusqu’à l’indifférence parfois.
Chercher à apaiser autrui, en ce sens, et lui demander pardon pourrait sembler une entreprise somme toute intéressée : j’ai besoin de recevoir son pardon pour me rapprocher de Dieu. Mais s’agit-il bien de cela ?
Le pardon implique des conditions précises : je dois demander pardon à celui que j’ai offensé, lésé ou blessé ; il doit accepter ma demande ; il doit m’en pardonner, c’est-à-dire « recouvrir » l’offense, la lésion ou la blessure par une parole qui l’apaise et qui m’apaise. Dieu alors peut m’en pardonner. Or ces conditions sont extrêmement difficiles, ainsi, pour la première, même si je demande pardon à mon prochain d’une faute que j’ai commise à son égard, je ne suis pas sûre du tout de mesurer l’impact de ma faute sur lui. Ma violence envers lui, par exemple, a pu avoir des conséquences que j’ignore sur l’estime où il est de lui-même, sur sa propre conduite envers ses proches, sur la douleur qu’il a pu transmettre à ses enfants etc. Pour la seconde, celui qui dit me pardonner - même s’il le fait très sincèrement, sans arrière-pensée - ne peut pas, pour autant, me pardonner les conséquences que ma faute a eu sur ses proches car c’est à eux - et à eux seuls - de le faire. Il n’y a pas de pardon par procuration et il y a de l’impardonnable aussi si la victime n’est plus là. Dès lors l’apaisement des uns et des autres reste très précaire, voire impossible, et Dieu continue d’attendre pour pouvoir nous pardonner car Il ne peut prendre son parti des fautes envers notre prochain lorsqu’elles restent sans réparation. Il ne s’arrange pas des souffrances restées inconsolées. Même Moïse demanda à Dieu de ne pas accueillir les hommages de Qorah et de ses partisans (Nbs 16, 15), ce qui signifie, selon Sforno, qu’il rappela à Dieu que Yom Kippour n’efface pas les péchés commis envers le prochain tant que ce dernier n’a pas donné son consentement. Or, en l’occurrence, c’était Moïse et Aaron - et non Dieu - qui se trouvaient offensés.
Que faire ? La Guemara qui commente cette Michna essaie de poser des limites, non pas par commodité mais pour rendre l’avenir possible, pour lui permettre de ne pas être hypothéqué par le mal commis et par le mal subi de façon fatale et, somme toute, mortelle. Demander pardon pour le mal commis, accorder son pardon pour le mal subi sont deux conditions nécessaires pour que cesse cette hypothèque, pour que l’avenir cesse de répéter le passé et que l’espoir renaisse. En effet, si le pardon est impossible dans l’absolu, pour les raisons que je viens d’esquisser, et aussi parce que nul ne peut effacer ce qui a eu lieu, faut-il pour autant ne pas tenter de réparer ce que nous pouvons réparer ? R. Yossi bar Hanina explique ainsi, dans cette Guemara, qu’il suffit de demander trois fois pardon à quelqu’un que nous avons offensé pour être quitte, même s’il refuse de nous pardonner. Ce qui signifie que cet autrui n’a pas le pouvoir de nous enfermer dans l’impardonnable si nous avons manifeste - de vive voix - que nous reconnaissons notre faute à son égard. S’il tente de le faire, de nous faire croire que notre culpabilité est inexpiable, c’est désormais lui qui a tort. Il s’enferme lui-même dans l’instant du mal subi et il refuse qu’il y ait pour lui un avenir nouveau. Pourtant, la Guemara raconte encore que Rav qui avait offensé Rav Hanina, alla lui demander pardon treize années de suite, à la veille de Kippour, sans que ce dernier ne s’apaise jamais. Cette insistance provient peut-être d’une prise de conscience aiguë de la faute, une conscience qui s’accroît avec l’humilité requise à Yom Kippour. Mais si, de son côté, Rav Hanina refuse de pardonner c’est parce que, comme le remarque Levinas, il est plus difficile de pardonner à Rav qu’au premier venu. Il est difficile de pardonner à celui qui est conscient de ce qu’il fait, qui est doué de qualités morales et intellectuelles, et qui, en outre, se prévaut de son engagement pour la Torah.
Qu’en déduire pour nous ce soir ? Il semble tout d’abord que nous devons éprouver une gratitude profonde d’avoir reçu un tel jour en partage, un jour de purification (tahara) et de recouvrement (kappara) de nos fautes envers Dieu. Il semble ensuite que la repentance (techouva) et l’humilité indispensables en ce jour - cette dernière va jusqu’à l’anéantissement de l’être pour soi, enseigne le Rabbi de Slonim, avec toute la tradition hassidique, dans ses homélies sur Yom Kippour - soient capables de nous rapprocher de Dieu, de sa présence en nous-même, présence que le Rabbi de Gur appelle le « point intérieur » (nequda haPenimiout). Or c’est précisément le contact retrouvé avec ce « point » qui nous donne - ou redonne - l’élan indispensable pour ne pas nous complaire à nos turpitudes, mais également pour ne pas vouloir enfermer autrui dans les siennes, même quand nous pensons qu’il est en tort à notre égard. Les deux ne vont-ils pas de pair ? Les deux attitudes en effet figent le temps sur l’instant de la faute (parfois aussi de ce qu’on imagine être une faute), ce temps ne peut plus passer. Cela signifie alors que je suis défini (e) par ma faute et qu’autrui est défini par la sienne : deux images qui nous enferment dans le ressassement, dans l’absence de mouvement et de liberté, deux images où, de fait, nous nous perdons nous-mêmes comme soi vivant.
Or un soi vivant, pour un juif, c’est un soi animé par la force des paroles de Dieu en lui-même, dans son âme. Il s’agit donc à Yom Kippour de retrouver le chemin de cette force pour se retrouver comme soi vivant, appelé à l’espoir, encore et malgré tout. La demande de pardon et le pardon accordé y jouent un rôle de premier plan, même si, comme je l’ai souligné, nous mesurons rarement les conséquences de nos fautes sur autrui et sur les siens, voire sur le reste de l’univers. Mais précisément ce jour vise aussi à aviver notre conscience de cette responsabilité là, à éveiller en nous le scrupule de nous comporter avec désinvolture à l’égard d’autrui, même dans ce qu’on croit être des choses sans importance.
Dans cette perspective donc, ce n’est pas la paix intérieure, somme toute égoïste, que la demande de pardon - et le pardon accordé - vise à obtenir : c’est la levée de tout ce qui pèse sur le soi et l’empêche d’être vivant, bien vivant (et pas forcément bon vivant !). Or un soi vivant reste habité par l’inquiétude, il ne cherche pas à avoir la paix, à se concilier les bonnes grâce de son Créateur (on a vu que c’est exclu). Il vise à faire la paix (ce qui est très différent) et à aviver l’alliance qui le relie aux créatures et seulement ainsi au Créateur. Il s’ouvre à une responsabilité plus grande que sa liberté, il découvre qu’il peut répondre de la création parce que, au plus profond de soi il n’est pas seul. La solitude de chacun et de chacune, le jour de Yom Kippour, est inévitable, même si nous sommes tous ensemble. Mais c’est parce que cette solitude est habitée, elle aussi, par la parole qui fit émerger la lumière des ténèbres et qui passa ensuite une alliance avec la nuit et le jour, que nous pouvons aussi nous relever. Cela commence quand nous percevons que la nuit aussi est une réserve de clarté.
Catherine Chalier, spécialiste et élève de Levinas, enseigne la philosophie à l’université de Paris-X-Nanterre. Elle a publié de nombreux ouvrages qui explorent le lien entre la philosophie et la source hébraïque de la pensée.
Sur le même sujet voir l’étude des lois de Maimonide sur la Teshouva