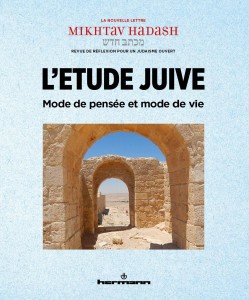Je ne suis pas personnellement fanatique du cinéma d’Amos Gitaï, mais j’ai été ici très agréablement surpris.
Amos Gitaï s’est attaqué à la question de l’identité juive diluée dans le silence et l’assimilation au catholicisme français.
C’est l’histoire d’une grand-mère, remarquablement jouée par Jeanne Moreau d’une très grande justesse dans son personnage, juive d’origine russe, convertie au catholicisme pour se marier avec un catholique français, « protégée » pendant la guerre, mais dont les parents ont été déportés… Depuis elle ne dit rien de sa judéité.
C’est l’histoire de son fils, énarque et haut fonctionnaire (Hippolyte Girardot toujours fin acteur), qui fouille dans le passé de la famille.
C’est l’histoire du petit-fils, adolescent un peu gauche et fade, qui découvre tous d’un coup la réalité sur sa grand-mère et donc aussi sur lui-même.
Amos Gitaï touche ici à la délicate question des « juifs du silence » français, ces marranes modernes qui ne disent pas leur nom : tous ces juifs qui ont appris à se taire, à masquer leur identité, se sont convertis au catholicisme en guise d’intégration dans une société qui aura fini par les déporter en masse… C’est tout un pan de la société française catholique et bourgeoise qui porte en elle une part d’identité juive sans vraiment le savoir et encore moins quoi en faire.
La situation décrite dans le film est emblématique d’une partie du judaïsme français, mélange de honte et de fierté, non-dits, ignorance d’un judaïsme vécu comme une espèce de tare qu’il faudrait cacher mais qui un jour ou l’autre ressort parfois à la lumière.
On n’attendait pas qu’Amos Gitaï l’israélien fasse un film sur un sujet si lointain pour lui. C’est une réussite.
Il montre comment des êtres humains, une culture, une identité, une religion – donc du vivant et de la vie – ont été réduits à l’état d’objets : vielles photos qui ne parlent pas vraiment, vielles lettres qui ne disent pas tout, adresses et appartements aux murs silencieux, bien spoliés, et même dédommagements… Un juif n’est plus un homme, il n’est plus vivant, il est réduit à l’état de souvenirs et de dossier administratif (celui de la police de la persécution – celui de la commission de dédommagement)…
Amos Gitaï fait ici un travail remarquable sur notre rapport à l’objet et sur l’impossibilité pour les objets de parler. Objets silencieux, qui sont tout ce qui reste d’une judéité engloutie par la société française, dans les mains du petit fils perplexe face au corps de sa grand mère maintenant éternellement silencieuse...
Yeshaya Dalsace
Le film
Alors que débute le procès de Klaus Barbie, à la veille de la mort de sa mère, Victor rompt le silence qu’elle a gardé sur la déportation de ses parents et renoue avec ses origines juives.
Au-delà de l’évocation de la Shoah et de l’histoire personnelle de Jérôme Clément, ce film reflète l’universalité des rapports mère-fils.
Film français. Avec Jeanne Moreau, Hippolyte Girardot, Dominique Blanc, Emmanuelle Devos. (1 h 28.)
La critique de Jacques Mandelbaum
Le nouveau film du réalisateur israélien Amos Gitaï contredit à peu près tous les principes liés au cinéma d’auteur. Il est d’abord le fruit d’une adaptation littéraire (le beau récit autobiographique de Jérôme Clément, paru en 2005 chez Grasset & Fasquelle). Il évoque une expérience typiquement française, a priori étrangère à celle du réalisateur. Il est enfin à la base un téléfilm (produit par France 2 où il est diffusé mardi 20 janvier) et ne relève pas, à ce titre, du cahier des charges économique et esthétique du cinéma.
Son passage sur grand écran ne laisse pourtant aucun doute : Plus tard tu comprendras est un très beau film, une brillante appropriation d’un récit dont la nature intime et grave à la fois aura nécessité autant de délicatesse que de talent.
L’histoire est celle de Victor Bastien (Hippolyte Girardot), baptisé et marié à une femme catholique, père de deux grands enfants, qui redécouvre au détour de la quarantaine l’identité juive de sa mère, Rivka Skornick (Jeanne Moreau), dont les parents, des juifs russes émigrés en France dans l’entre-deux-guerres, sont morts en camp d’extermination.
Le film commence en 1987, durant le procès Barbie. Victor, dont la mère continue de faire peser sur cette histoire tragique un lourd poids de silence, entreprend de découvrir par ses propres moyens, à travers un travail de recherche dans les archives familiales et publiques, cette part de lui-même dont il se sent coupé.
Obnubilé par cette recherche, Victor entre petit à petit dans une histoire à laquelle il ne pressentait pas qu’il appartenait, et qui redéfinit sa relation au monde et à ses proches, qu’il s’agisse de sa mère, de sa soeur (Dominique Blanc), de sa femme (Emmanuelle Devos) ou de ses enfants.
La réussite du film tient à la fois à un sujet fort, qui confronte le personnage principal à des questions existentielles profondes, et à une forme, celle de l’enquête, propice à soutenir l’intérêt du spectateur.
Mais rien de tout cela ne fonctionnerait sans la tenue de la mise en scène. Gitaï a énormément taillé dans le livre, mais il distille l’essentiel en quelques grands blocs narratifs, tournés en plans-séquences. Ce sont autant de moments admirablement choisis, filmés et interprétés, d’une nécessité absolue dans la dramaturgie et d’une intensité bouleversante.
La décision de filmer dans l’intimité des appartements, notamment celui de Rivka qui devient l’épicentre du film, la manière dont la caméra se déplace en sinueux travellings qui tour à tour perdent et retrouvent les personnages, la façon de saisir le rapport de ces derniers à l’espace et au temps, tout cela fait du film une archéologie de la mémoire. Cette approche témoigne d’une forte sensibilité aux horreurs de l’Histoire, à la transmission qui peut en être faite, mais aussi à la manière de les représenter.
Deux séquences sont exemplaires. La première est celle du voyage à Salviac, qui produit le seul retour en arrière du film. Victor est seul dans la chambre d’hôtel où ont été arrêtés ses grands-parents, sa main touche le mur, et nous voilà en 1944. Le style de ce flash-back, fragmenté, tourné à l’épaule, halluciné, est violemment distinct du reste du film. C’est une façon de suggérer qu’il est impossible, sauf à tricher, de représenter la réalité de l’horreur autrement que par le biais d’une vue de l’esprit.
Second moment admirable : Rivka confiant à ses petits-enfants, en même temps que son secret, son étoile jaune. A savoir que le secret, ce n’est rien d’autre que ce bout d’étoffe. Car de l’abjection du crime et de l’indignité du sort réservé aux victimes, nul ne peut prétendre témoigner. Ce talisman jalousement gardé ne saurait servir qu’à exorciser les démons du temps présent.
Reste donc Victor, à qui ce don fut épargné, faisant de lui un éternel enfant, tout à la fois sacrifié et sauvegardé. Confronté à la liquidation des biens de sa mère puis aux questions de la commission d’indemnisation des victimes juives, l’orphelin qu’il est devenu et qu’il n’a sans doute jamais cessé d’être ne sait que penser ni que répondre. Du moins sait-il désormais que le préjudice est immense et qu’il n’y aura jamais de compensation.
Critique parue dans Le Monde 2009