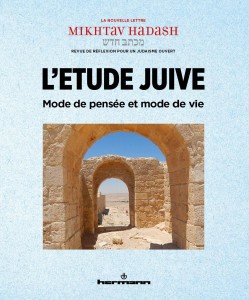Le retour des Juifs ?
La sonnerie de son téléphone mobile retentit au moment où il parle, dans un roumain parfait, sur sa ligne fixe. Jacob Fonea, homme d’affaires israélien installé à Bucarest, prend la communication.
Les deux combinés collés à ses oreilles, il passe du roumain au yiddish sans la moindre trace d’accent.
De son bureau, situé au quatrième étage d’un immeuble flambant neuf, il balaie du regard le quartier Primaverii (Printemps), ancien fief de la nomenklatura communiste. La villa préférée de feu le dictateur Nicolae Ceausescu se trouve à deux pas de là. Mais, dix-sept ans après la chute de la dictature, le communisme est bien mort en Roumanie. Le pays est entré dans l’Union européenne au 1er janvier.
"A Bucarest, je me sens chez moi comme à Haïfa, en Israël, affirme Jacob Fonea. La seule différence c’est qu’ici il n’y a pas les missiles du Hezbollah." Sa vie est partagée entre les fins de semaine, passées en Israël aux côtés de sa famille, et des séjours à Bucarest pour gérer les affaires. "Deux heures et demie de vol, quatre vols réguliers par jour, ça va", précise-t-il. Son groupe, Alpha - textiles, céramique, chimie et pétrochimie -, fait travailler environ 3 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. Même dans ses plus beaux rêves, l’ancien stomatologue, que ses employés continuent d’appeler "Monsieur le Docteur", n’aurait pu imaginer pareille réussite.
En 1965 - il avait 8 ans -, sa famille quitte la Roumanie, direction Israël. Les grands-parents ont été déportés et gazés à Auschwitz pendant la seconde guerre mondiale. Alliée de l’Allemagne nazie, la Roumanie s’est rendue coupable de la déportation d’au moins 400 000 juifs. Après la guerre, l’Etat communiste qui s’est installé les traitera comme une marchandise, empochant 10 000 dollars de "compensation" pour chaque juif en partance pour Israël. La Roumanie comptait 800 000 juifs avant la guerre ; en décembre 1989, lorsque le régime communiste est renversé, ils sont moins de 10 000. En Israël, les juifs d’origine roumaine sont autour de 500 000.
"Je suis revenu en Roumanie en 1990 aussitôt après la chute de la dictature, affirme le stomatologue converti au business. C’était le vide total, on ne trouvait rien. Les grandes sociétés n’osaient pas s’aventurer dans ce pays. J’ai commencé par importer des appareils de climatisation. Ceausescu ne supportait pas la "clim", et il n’y avait que six appareils dans un pays de 22 millions d’habitants. Il interdisait aussi les contraceptifs, se souvient-il. Les pharmacies ont été très vite privatisées, mais je ne pouvais pas faire face aux commandes. Le principal problème était qu’on ne pouvait convertir l’argent roumain en devises pour le sortir du pays. Alors j’ai investi dans les textiles et j’ai misé sur l’exportation. J’avais 32 ans, j’étais un jeune loup passionné des affaires."
L’aventure de Jacob Fonea n’est pas singulière. Les enfants de l’Holocauste sont nombreux à revenir dans un pays jadis déserté par leurs parents pour d’excellentes raisons. On compte aujourd’hui en Roumanie environ 3 500 entreprises israéliennes et 15 000 hommes d’affaires juifs qui ont injecté dans ce pays autour de 2 milliards d’euros. Agroalimentaire, haute technologie, industrie militaire, banques et bâtiment sont leurs domaines d’investissement privilégiés. " C’est une deuxième génération de juifs qui se sentent attachés à la terre natale de leurs parents, explique Aurel Vainer, député et président de la communauté juive de Roumanie. Ils parlent le roumain et ils ont la capacité financière pour intervenir sur ce marché. Dans le monde des affaires, le contact direct est essentiel si l’on veut saisir les nuances. Dans le business, ce sont les nuances qui comptent."
Dans la politique aussi, est-on tenté de dire. Les relations entre Bucarest et Israël ont toujours été "spéciales". Même à l’époque communiste, la Roumanie était le seul pays du bloc soviétique à cultiver des relations diplomatiques assez étroites avec l’Etat juif. Aujourd’hui, les deux pays sont liés par vingt-trois accords économiques concernant le libre-échange et garantissant les investissements.
"Les juifs ont cru dans l’avenir de ce pays, explique Jose Iacobescu, président de la Chambre de commerce et d’industrie roumano-israélienne. C’est pour cela qu’ils ont investi ici. Quand je regarde en arrière, il me semble que j’ai vécu un miracle." Lorsque la dictature est tombée, M. Iacobescu était ingénieur automobile. Tout de suite, il est allé voir l’attaché commercial de l’ambassade d’Israël à Bucarest et a proposé la création de la chambre de commerce qu’il préside. "Le gouvernement roumain s’est montré coopératif et a sorti une ordonnance d’urgence pour nous donner le feu vert, se souvient-il. C’était la première chambre de commerce bilatérale après la chute du communisme. Nous avons pu accélérer les investissements juifs en Roumanie, mais il faut dire que ce pays présente aujourd’hui de grands avantages pour les étrangers."
Introduit en 2005, le taux unique d’imposition - 16 % sur le profit des sociétés et les revenus des employés, quels que soient leurs niveaux - a simplifié la fiscalité et rassuré les investisseurs. Résultat : alors qu’en quatorze années, entre 1990 et 2004, la Roumanie n’avait attiré que 14 milliards d’euros d’investissements étrangers, en deux ans - 2005 et 2006 - elle en a obtenu au moins 15 milliards.
"Aujourd’hui, estime Jose Iacobescu, il y a très peu d’antisémitisme en Roumanie." Mais dans un pays qui a sérieusement failli déraper dans un nationalisme étroit et intolérant au début des années 1990, la prudence reste de mise. Quand ils débarquent à l’aéroport de Bucarest, les hommes affaires juifs ne se précipitent pas pour mettre une kippa. Le pays compte encore quelques organisations d’extrême droite antisémites qui ne cessent de dénoncer le "danger juif". Ainsi le parti extrémiste Romania Mare (La Grande Roumanie), qui a eu le vent en poupe dans les années 1990. Depuis 2000 pourtant, année où la Roumanie a entamé les négociations d’adhésion à l’UE, les poussées "patriotardes" se sont calmées. "Entre-temps, le pays a décidé d’affronter son histoire et l’Holocauste, assure Rodica Radian-Gordon, ambassadrice d’Israël à Bucarest, elle aussi d’origine roumaine. La reconnaissance officielle de l’Holocauste, une journée commémorative annuelle de cet événement, les nouveaux manuels scolaires et un futur Mémorial de la déportation ont changé la donne."
Le 24 octobre 2006, le groupe Leumi, deuxième réseau bancaire d’Israël, s’est installé en Roumanie. "Le milieu bancaire est très conservateur, précise Arnon Arbel, conseiller économique à l’ambassade d’Israël. Une banque comme Leumi ne s’installe dans un pays qu’après une analyse très poussée du marché. La Roumanie connaît actuellement le taux de croissance le plus élevé d’Europe, et ce pays servira de tête de pont entre les sociétés israéliennes et l’Europe centrale. Leumi est une banque d’investissements très puissante qui va attirer les grandes entreprises israéliennes sur le marché roumain."
Les relations économiques entre Israël et la Roumanie ne sont pas à sens unique. Si les enfants de l’Holocauste viennent à Bucarest, les enfants de la dictature roumaine vont aussi en Israël. Environ 200 000 Roumains sont partis travailler en Terre sainte, la plupart dans le bâtiment. De retour chez eux, ils possèdent non seulement un pécule, mais ils ont acquis une certaine connaissance de l’hébreu, ce qui fait l’affaire des entreprises israéliennes à la recherche de main-d’oeuvre qualifiée dans les Carpates.
Problème : dès avant 2007, la perspective d’adhésion à l’UE a littéralement bousculé l’économie roumaine. Depuis 2002 déjà, les citoyens roumains circulent sans visa dans l’espace Schengen de l’Union, et environ deux millions et demi d’entre eux y sont partis travailler. Du coup, un nombre grandissant d’entreprises locales sont confrontées à une pénurie de main-d’oeuvre. Certaines d’entre elles en sont venues à embaucher des Chinois, moins exigeants sur les salaires. "Je suis obligé de transférer deux unités de production d’une de mes entreprises de textile en Moldavie ex-soviétique, déclare Jacob Fonea. Mon problème est que je ne trouve plus assez d’employés roumains pour produire les pull-overs que j’exporte dans l’Union européenne."
L’ancien stomatologue dévoile le secret très personnel de son succès : "Ce pays m’a toujours fait l’effet de déjà-vu." Israël et la Roumanie, selon lui, ont un peu vécu la même histoire économique, à une vingtaine d’années de distance. "M. le Docteur" a connu la libéralisation et l’inflation à 400 % l’an en Israël. La Roumanie a suivi le même processus. "Quand je suis arrivé à Bucarest, j’ai retrouvé les mêmes problèmes que ceux que j’avais connus en Israël dans mon adolescence. C’était un grand avantage par rapport aux autres investisseurs. Les juifs ont tout de suite compris que la Roumanie allait décoller parce qu’ils étaient passés par là." Après avoir allumé une énième cigarette, Jacob Fonea philosophe. "On est stressé jusqu’à ce qu’on gagne les deux premiers millions d’euros. Et puis, quand on arrive à 100 millions de chiffre d’affaires, l’argent ne nous intéresse plus. Aujourd’hui, c’est la passion qui me retient dans le business, car je veux laisser quelque chose derrière moi dans ce pays qui m’a tant donné."
Mirel Bran
Article publié dans Le Monde 22.01.07
La fin du judaïsme roumain
Ghidu Bruchmaier, l’un des doyens de la communauté juive de Bucarest est décédé au milieu de l’été 2010.
" Dans le plus humble des juifs vivant, je me sens revivre", disait Franz Rosenzweig. C’est ce que j’ai ressenti au contact de cet homme, habité par la Torah et le Talmud et dont la parole passait toujours par la chair - une clarté sidérante dans le fond des yeux, des gestes qui semblaient toujours portés par une Présence intérieure.
Comme les traits d’une très vieille dame, le cimetière juif de Bucarest se laisse ravager par le temps. Les herbes sauvages plongent les tombes dans un irréversible oubli. Et la communauté laisse faire. Elle sait trop bien que jamais plus elle n’aura assez de mains, assez d’argent pour réparer, entretenir. Et pragmatiques, lucides, presque tous l’admettent : dans quelques années, il n’y aura plus de Juifs en Roumanie.
« Il n’y a pas grand-chose à faire, estime le jeune Iavi Rotberg. Notre temps ici est terminé. Les jeunes ne rêvent que de partir. »
Son père Isaïa est né dans la petite ville de Jassy, située sur la route commerciale traditionnelle vers la Russie. Plus de 45 000 Juifs vivaient, en 1940, dans ce qui fut longtemps le poumon culturel du pays. Il n’en reste plus que 300. Comme son fils, il n’est envahi ni par la tristesse, ni par la résignation : « Tout a un début et une fin. Désormais, il n’y a plus de culture à transmettre. » à Jassy, aujourd’hui, on ne trouve plus un seul magasin casher . « Et je vous mets au défi de trouver une famille qui fête le shabbat ! »
Même à Bucarest, le quartier juif a disparu. Des 150 synagogues et lieux de cultes d’avant-guerre, quatre seulement n’ont pas été rasées.
Seule trace de la culture yiddish si forte dans toute l’Europe centrale et orientale avant la Shoah : la devanture d’un théâtre où se jouent encore quelques pièces. Mais le répertoire y est de plus en plus restreint et pour en comprendre la langue, les spectateurs ont désormais besoin de casques.
Quelques expressions ont bien trouvé refuge dans la langue roumaine, mais le yiddish n’est plus guère parlé que par de vieux sages . « L’un des derniers grands auteurs vient d’ailleurs de mourir », annonce, la barbe hirsute, un homme sans âge sur le pas de la porte de la petite maison d’édition Hasefer, qui jouxte la synagogue de l’Union sacrée.
L’antidote à l’antisémitisme
Ici, même le rabbin principal, Schlomo Sorin Rosen, est un converti, et attend patiemment de rejoindre le Canada l’an prochain, comme pour échapper au naufrage : « C’est difficile d’être juif dans ce pays. Nous étions 800 000 en 1940, nous ne sommes plus qu’environ 6 000. Et sur ces 6 000, il reste quoi, 20 ou 30 pratiquants ? Les gens ont passé leur vie sans religion ; ils ne sont pas totalement assimilés mais presque. Ce ne sont plus que des Juifs culturels, attachés à l’état d’Israël et conscients de l’antisémitisme. »
Ce matin, comme tant d’autres, la communauté microcosmique se réunit au cimetière pour un enterrement, dans la partie mixte, qui compte de plus en plus de tombes. Signe de l’assimilation opérée pendant les années communistes. Les autres, l’immense majorité des survivants de la Shoah, ont préféré quitter le pays après la guerre. Petits artisans, cordonniers, tailleurs et modestes commerçants pour la plupart, ils ont vite compris, lorsque le régime totalitaire a nationalisé le pays, qu’il n’y avait plus de place pour eux. L’émigration vers Israël est ainsi devenue, dès 1948, l’antidote à l’antisémitisme, l’horizon, le grand souffle. Un lien d’autant plus fort que les Juifs roumains furent parmi les premiers, dès 1882, à incarner le sionisme. Avant même le congrès de Bâle organisé par Theodor Herzl en 1897, plusieurs centaines d’entre eux rejoignirent la Palestine dans une précarité absolue pour y créer des villages agricoles.
Un emprisonnement à ciel ouvert
L’armée des ombres qui remonte humblement la grande allée centrale du cimetière concentre donc à elle seule tout ce qu’il reste de l’âme juive de Bucarest. Durant l’après-guerre, nombre de Juifs furent vendus à Israël, le régime communiste ouvrant et refermant les vannes de façon capricieuse, arbitraire. Mais certains ne passèrent jamais entre les mailles du filet et menèrent ainsi leur existence dans une forme d’emprisonnement à ciel ouvert. Seule une minorité décida, de son plein gré, pour une raison intime, profonde, l’exil intérieur au départ. Et il demeure presque impossible pour eux d’expliquer ce choix sans laisser passer un silence, parfois un sanglot.
Un massacre planifié
À l’inverse, les mots sont difficiles à contenir quand il s’agit d’évoquer les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. « Pendant près de cinquante ans, la Roumanie n’a pas voulu reconnaître qu’elle aussi avait participé activement à la Shoah, témoigne l’historien Carol Iancu. On préférait parler de citoyens roumains tués par des fascistes. »
Le rapport mené sous la direction d’Elie Wiesel, publié en 2004, estime pourtant entre 280 000 et 380 000 le nombre de victimes juives en Roumanie et dans les territoires sous son contrôle. Il pointe la responsabilité directe des autorités dans la planification et la mise en œuvre de ce massacre. Le texte se réfère aussi aux travaux de l’historien américain Raul Hilberg qui considère qu’aucun autre pays, à part l’Allemagne, n’a été impliqué à une telle échelle dans le massacre des Juifs.
Il y eut donc, d’abord, le déni des années communistes, commun à tous les régimes sous domination soviétique, et qui consista à rejeter la faute sur l’Allemagne. Mais il y eut pire. Dès 1989, après la chute du régime de Nicolae Ceauşescu, le maréchal Antonescu, premier responsable de l’extermination des Juifs, connut une phase de réhabilitation. « On pouvait trouver des rues à son nom, des statues à son effigie, explique Isaïa Rotberg. Les Roumains ont eu du mal à admettre qu’un homme qui a sauvé la nation puisse aussi être un criminel de guerre. »
Depuis quelques années, le travail de vérité est à l’œuvre : un mémorial a été inauguré en 2009 dans le centre de Bucarest. Les autorités ont également créé une journée annuelle de commémoration de l’Holocauste, le 9 octobre, jour anniversaire du début de la déportation des Juifs roumains vers la Transnistrie, et voté une loi (guère appliquée) punissant tout acte de négationnisme en 2006.
Les stigmates, les odeurs, la peur
Pendant plus de cinquante interminables années, les Juifs roumains furent condamnés au silence. Certains n’en ont jamais parlé jusqu’à ce jour. Il fallait oublier, se faire oublier. Mais pas une heure n’est passée sans qu’ils y songent. Leur corps comme leurs âmes en ont gardé les stigmates. Comme ils ont conservé intacts les cartes de géographie de l’époque, les photos, les documents attestant de la déportation, les odeurs, la peur. Pour l’évoquer, Gertrud Reicher préfère tendre pudiquement un papier sur lequel son mari a consigné en français le récit détaillé de ces années.
Le bannissement en Transnistrie
Pour elle, tout commence en 1941. Un an auparavant s’effondrait la grande Roumanie, créée en 1919 et contrainte à présent de céder la Bessarabie et la Bucovine du Nord à l’Union soviétique, la partie nord de la Transylvanie à la Hongrie, et la partie sud de la Dobroudja à la Bulgarie. Ion Antonescu, militaire de carrière, héros de la Première Guerre mondiale, installe alors un régime de terreur et s’engage aux côtés d’Hitler.
Il organise la discrimination systématique des Juifs. Ces derniers sont éliminés de tous les secteurs de la vie publique, interdits de mariages mixtes, ils endurent violences, arrestations arbitraires, expulsions de domicile, assassinats. La purification ethnique est encouragée par des déportations et des exécutions de masse. En Bessarabie et en Bucovine du Nord, reconquises durant l’été 1941, des dizaines de milliers d’entre eux sont tués.
Gertrud vient d’avoir 13 ans, elle est évacuée de sa campagne natale vers la ville la plus proche, Vatra Dornei, pour être ensuite déportée vers la Transnistrie, ce territoire ukrainien passé en août 1941 sous administration roumaine, devenu lieu central de bannissement et de mort pour les Juifs de Roumanie. « Tout a été pensé, pour les faire mourir de faim, de froid et de maladie. Le dessein, c’était ça, résume son mari. Après cette expérience, mon épouse a connu toute son existence une immense souffrance morale. C’est moi qui porte sa vie. » Gertrud : « Oui, mais je n’ai jamais haï personne. » Quelques mois avant elle, le 29 juin 1941, Leizer Finchelstein a lui aussi été arraché à son domicile avec toute sa famille et mené à la préfecture de police. « Il y régnait une violence abominable », dit-il le souffle coupé et les larmes aux yeux.
Cette nuit-là, dans les rues de Jassy, des milliers de Juifs sont torturés, fusillés, et dans la cour de la préfecture de police où Leizer se trouve, on tire à la mitrailleuse sur les 5 000 ou 6 000 prisonniers entassés.
Mais ce n’est qu’un début. Quelques heures plus tard, avec quatre de ses frères, le jeune homme de 17 ans se retrouve dans un convoi à bestiaux scellé. « Il pouvait contenir 40 personnes, nous étions 120 à l’intérieur. Le trajet n’a duré que quelques heures, mais c’était comme une chambre de la mort. à l’arrivée, on a retrouvé 100 cadavres. Les plus chanceux ont survécu en buvant leur urine, les autres sont morts de soif, de chaleur et d’asphyxie. Nous devions pousser les cadavres dans un coin au fur et à mesure. Puis, nous sommes arrivés à Podul Iloaiei à 20 km de Jassy et le lendemain, nous avons dû creuser leurs tombes. »
Une « Shoah inachevée »
Le mari de Gertrud, qui connaît bien Leizer, complète le récit : « C’est un homme de très haute taille. Dans le wagon, il a trouvé un petit espace dans le plafond, entre les planches, d’où il put respirer. »
Le bilan exact du « premier pogrom gigantesque de la Seconde Guerre mondiale », perpétré par l’armée et les autorités civiles roumaines avec la complicité et l’aide des unités allemandes, est estimé à environ 12 000 victimes, tuées en ville, mortes de soif ou d’étouffement.
Leizer Finchelstein passa ensuite plus de deux ans dans des camps de travail, échappant, comme Gertrud, à la déportation vers le centre polonais de mise à mort de Belzec. Échappant aux chambres à gaz. Le maréchal Antonescu, qui avait d’abord accepté d’y envoyer les derniers Juifs de Roumanie, changea brusquement d’avis en octobre 1942 : « En bon stratège militaire, estime l’historien Carol Iancu, Antonescu avait réalisé, avant Stalingrad, que le rapport de forces changeait, qu’un jour il devrait rendre des comptes. » Environ 50 % des Juifs roumains ont réchappé à la Shoah, ainsi qualifiée d’« inachevée ».
Le 23 août 1944, Leizer Finchelstein est libéré du camp de travail. « J’avais 20 ans. Les poux étaient tellement incrustés sous ma peau qu’ils ont été presque impossibles à enlever. » Il a continué à vivre, s’est marié à une Juive achkénaze, aussi victime d’atrocités. Ils ont emménagé dans un appartement modeste d’un quartier populaire de Jassy, « avec des toilettes et une baignoire ». Ils n’ont pas eu d’enfant. Ne se sont « jamais querellés ». Leizer a aimé la période communiste, son travail au sein de la compagnie ferroviaire nationale. Et aussi l’accueil, chaque soir, de son épouse sur le pas de la porte. Il n’a plus jamais mis un pied à la synagogue.
« Le peu est notre ami »
« On est habitués du peu. Le peu est notre ami », confie Ghidu Bruchmaier, l’un des doyens de la communauté religieuse de Bucarest. Au milieu des corbeaux, des feuilles mortes et des chiens errants qui embrassent la tombe fraîchement creusée de son ami, il nous ramène à ce qui, ici comme ailleurs, ne cessera jamais de briller : la conscience juive. « Aime ton prochain comme toi-même », glisse t-il en hébreu. Puis en roumain : « On doit respecter chaque homme comme si tout en dépendait. Cela vaut la peine de supporter la barbarie. »
Jennifer Schwarz
Article publié dans Le Monde des Religions en janvier 2011.
Pour aller plus loin
■ Carol Iancu, La Shoah en Roumanie (Université Paul-Valéry-Montpellier, 2000), Alexandre Safran et la Shoah inachevée en Roumanie (Hasefer, 2010).
■ Alain Guillemoles, Sur les traces du Yiddishland (Les Petits Matins, 2010).