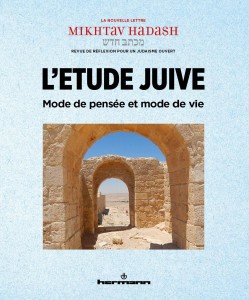Notre Parachah commence ainsi : « Et il arrivera, lorsque tu entreras dans la terre que la Transcendance ton Dieu te donne en possession, que tu en hériteras et que tu t’y installeras, tu prendras des prémices de tout fruit de la terre que tu apporteras de ta terre que la Transcendance ton Dieu te donne, tu les mettras dans un panier et tu te mettras en route vers le lieu que la Transcendance ton Dieu choisira pour y faire résider son Nom » (Deutéronome 26, 1-2). Suit alors la déclaration devant le prêtre que nous lisons à Pessah et qui constitue le canevas de toute la liturgie du Seder, c’est-à-dire de tout ce que nous devons dire (Magid) et transmettre à nos enfants lors de cette fête : comment nous sommes descendus en Egypte, comment nous y avons été asservis, et comment la Transcendance nous en a fait sortir pour nous amener sur cette terre (Deutéronome 26, 3-11).
L’entrée sur la terre, qui semble à première vue accomplir le plus grand rêve, signifie en même temps le plus grand danger. Car en en mangeant les fruits et en nous rassasiant de sa richesse, nous risquons aussi de nous laisser manger par elle, de nous croire parvenus, tellement bien entrés et installés dans notre héritage que nous le possédons désormais, en sommes les maîtres absolus et pouvons nous reposer dans cette possession et cette certitude puisque nous y avons accompli ce qui avait été promis. N’est-ce pas le rêve de toute vie accomplie : arriver au repos que procurent certitude et maîtrise, enfin pouvoir nous contenter de ce qui est et de ce que nous sommes pour en jouir sans entraves ? Tout est accompli, il n’y a plus rien à attendre au-delà de la jouissance de cet accomplissement. Et tous les rêves et appels s’affaissent et s’effondrent dans cet accomplissement et dans sa plénitude.
C’est pourquoi notre texte insiste par deux fois sur le fait que cette terre dont nous prenons possession, est un don toujours présent : elle porte en elle une référence à une extériorité qui par son don toujours en train d’advenir, nous interdit de nous croire parvenus, si nous voulons encore recevoir ce don comme présent. Elle nous demande donc de nous remettre en mouvement, d’échapper à un accomplissement total en prenant les premiers fruits de l’accomplissement – de la récolte – pour nous mettre en mouvement avec eux. Elle relance ainsi notre histoire en nous rappelant qu’elle est innervée de l’intérieur par un appel à la libération qui ne doit jamais cesser de retentir et de nous ébranler. C’est précisément lorsque je crois être parvenu sur la terre, que le rite vient me remettre en mouvement pour m’obliger à m’arracher à ma sédentarité et à mon accomplissement, et relancer mon histoire en me forçant à me souvenir d’un appel qui la porte et qui dépasse tout accomplissement possible – fût-il économique ou politique.
C’est donc seulement en faisant référence au passé de la libération de l’esclavage que je puis hériter la terre et mériter mon présent comme présent, c’est-à-dire comme don. Car ce passé me rappelle que l’homme ne peut pas se contenter de ce qui est sans tomber dans la violence et l’injustice, l’oppression et l’aliénation – et quel plus grand accomplissement y a-t-il eu sinon celui de l’Egypte ? Tout accomplissement qui se prétend total, ne peut se construire que sur l’oubli des faibles et des opprimés qu’il prétend englober et rédimer. L’homme ne peut donc jouir de ce qui est sien – et se réjouir devant la Transcendance de tout le bien qu’elle lui a donné avec le Lévi et l’étranger (Deutéronome 26, 11) - que s’il est capable de reconnaître que cela lui vient d’ailleurs et d’aller reconnaître cet ailleurs en montant devant le prêtre à Jérusalem. Ce qui est n’a de sens que par ce qui vient : c’est de cette mémoire du futur que témoigne la sortie d’Egypte et le rite qui la porte.
Yedidiah Robberechts
Parmi les passages les plus connus du Deutéronome, nous trouvons le célèbre « Souviens-toi de ce qu’Amalek t’a fait » [Deut ; 25 :17]. Or, il nous semble que pour comprendre ce que le méchant Amalek a fait, il est fondamental d’aller chercher dans le premier récit de l’évènement, dans le livre de l’Exode, où nous lisons :« Il [Moché] donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les Bnei Israël cherchèrent querelle et parce qu’ils mirent YHVH à l’épreuve en disant : « YHVH est-il en nous, ou non ? » Et Amalek survint et combattit contre Israël à Rephidim. »
Il est assez clair par ce passage qu’Amalek représente l’oubli de quelque chose qui est vital, et c’est à cause de cela qu’il est fondamental de s’en souvenir. Ce qui « crée » Amalek et le matérialise, est l’éloignement de la conscience intime, profonde et naturelle, de la sensation de faire partie du Un, exprimée par la question « YHVH est-il en nous, ou non ? », qui mène au déni du Transcendant en nous.
Nous trouvons l’écho de cela dans le passage du Deutéronome qui est normalement considéré comme la base pour la Mitzva de la Téchouva, c’est-à-dire du retour : « Et tu reviendras à YHVH, ton Dieu, et tu obéiras à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd’hui ; et YHVH, ton Dieu, reviendra avec tes captifs et aura compassion de toi … » [Deut. 30 : 2-3]. De la lecture de ce passage il ressort clairement qu’il s’agit de ramener deux entités à un état d’unité, un état qui quelque part, précède la conscience d’être en tant qu’entité séparée et indépendante. Comme si nous avions perdu la conscience d’être unis et liés à tout le reste, et d’être aussi part du Divin, qui à son tour est part de nous. Mais le Divin lui-même aurait perdu cette conscience, כביכול, si on peut dire ainsi, c’est pourquoi la Tora nous dit qu’il fera aussi retour.
Rester dans l’oubli de cet Un dont nous faisons partie signifie être victimes d’Amalek. Essayer de recomposer cette unité est un des sens profonds de la Téchouva.
Haim Cipriani