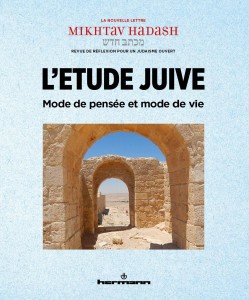Qu’est-ce qui a changé dans le rapport entre chrétiens et juifs depuis les lendemains de la Shoah, il y a soixante ans ?
Paul Thibaud : Ce qui a changé, c’est le fait, pour les chrétiens, d’admettre la permanence du peuple juif après l’Incarnation du Christ. C’est l’idée que cette permanence du peuple juif, ou son " endurcissement ", comme disait l’apôtre Paul, contribue même, d’une certaine manière, au salut des nations. Une fois ce pas considérable franchi par l’ensemble des Eglises, on peut s’interroger sur le rapport nouveau qui s’annonce. Pourquoi dialoguer, en soi ou entre soi ? A cela le pape Jean Paul II a répondu clairement : pour savoir qui nous sommes. C’est l’identité chrétienne qui se formule face au judaïsme dont elle vient, mais qu’elle ne pourra jamais complètement assimiler, réduire à elle-même. Du reste, l’introduction de textes de l’Ancien Testament dans la liturgie montre que la méditation et la célébration chrétiennes ne se font pas en oubliant le peuple juif.
Alain Finkielkraut : Je dois d’abord préciser que je ne suis ni un notable communautaire ni un juif de l’étude. Notre rencontre n’est pas celle d’un représentant autorisé du judaïsme avec un intellectuel chrétien. Je parle en mon nom et j’observe, moi aussi, un très grand événement : après le traumatisme de l’extermination et le malaise provoqué par le " silence " du pape Pie XII, l’Eglise a rompu avec ce que Jules Isaac, dont on sait l’influence qu’il a eue sur Jean XXIII, le plus grand pape du XXe siècle, appelait " l’enseignement du mépris ".
Hérité de saint Paul, le mépris chrétien visait le juif charnel. Il se fondait sur une opposition tranchée entre l’esprit et la chair. L’esprit, c’était la foi. Et la chair, c’était principalement deux choses : la filiation et la convoitise. L’universalité de la Nouvelle Alliance était censée avoir mis fin au privilège héréditaire des descendants d’Abraham, et les juifs étaient accusés de ne pas comprendre leurs propres Ecritures : celles-ci annonçaient le règne de la charité, mais, comme ils étaient eux-mêmes incapables de s’élever au-dessus des valeurs matérielles, ils furent, comme dit Pascal, déçus " par l’avènement ignominieux et pauvre du Messie " et ils en devinrent les plus cruels ennemis.
Ce mépris n’a plus cours. En 1980, à Mayence, lors de sa rencontre avec la communauté juive d’Allemagne, Jean Paul II a salué " le peuple de Dieu de l’Ancienne Alliance qui n’a jamais été révoquée ". Le juif charnel est réhabilité. L’Eglise fait droit désormais à l’expression dans laquelle tous les juifs se reconnaissent : " De génération en génération. "
La " repentance " dans le monde chrétien n’a pourtant pas fait l’unanimité
.
P. T. : Elle est acceptée en France depuis la déclaration des évêques à Drancy en septembre 1997. Ce qui paraît moins clair, c’est la substance de cette repentance. On reconnaît qu’en dépit de la participation des chrétiens au " sauvetage " de beaucoup de juifs en France (la consultation du Livre des Justes est à cet égard probante), l’Eglise en tant qu’institution n’est intervenue que grâce à une poignée d’évêques. On sait que les jésuites de Fourvière qui ont fait Témoignage chrétien n’ont pas obtenu une protestation de la faculté de théologie. La question du rapport entre l’antijudaïsme de la tradition chrétienne et l’antisémitisme moderne est également ouverte. La déclaration Nous nous souvenons du Vatican (1998), qui les séparait complètement, n’a pas convaincu.
On ne peut, dans l’autre sens, dire, comme l’ont fait Jules Isaac et Raul Hilberg, que le nazisme est un concentré virulent de l’antijudaïsme chrétien. Le nazisme était antichrétien. Pourtant, il est apparu en terre de chrétienté, entre Vienne et Munich, d’où il s’est diffusé dans toute l’Allemagne. Cela renvoie aux effets d’une domination cléricale qui a pesé à la fois sur le judaïsme marginalisé et sur le peuple chrétien lourdement encadré. Le nazisme est apparu quand les pouvoirs politiques sur lesquels s’appuyait cette domination ont été ébranlés. La révolte contre l’oppression cléricale que le nazisme exprime s’est retournée contre ceux - les juifs - que ces pouvoirs avaient marginalisés. Au-delà de la réflexion que cet épisode suggère sur les effets de certains régimes de chrétienté, cela indique aussi une tâche actuelle et nouvelle : celle de partager l’histoire avec les juifs, de nous placer avec eux dans une attitude de responsabilité pour le monde que nous habitons.
A. F. : Quand une génération se livre à la repentance, c’est pour affirmer, en réalité, sa supériorité morale sur les générations précédentes. La France est aujourd’hui peuplée de pénitents arrogants qui auraient pris le maquis dès 1940 et qui hurlent au fascisme à la moindre occasion pour bien montrer de quel bois résistant ils se chauffent. Cette repentance n’est pas un mea culpa, c’est une pratique effrontément narcissique et anachronique de la mémoire.
Mais l’Eglise est une institution. Rapport de soi à soi, la repentance lui coûte. Celle-ci est donc authentique et d’autant plus nécessaire que la malédiction du juif charnel est l’argumentaire fondamental où puisent tous les antisémitismes, même le racisme nazi. Il serait trop facile de réduire le nazisme à un déchaînement de paganisme contre la civilisation judéo-chrétienne. Les Aryens, dans la vision nazie, étaient les dépositaires de l’Idéal, la race de l’Esprit ; c’est pour libérer l’humanité de l’étreinte du matérialisme qu’ils ont entrepris l’extermination de la " race juive ".
P. T. : Un idéalisme de la race, c’est bizarre pour les nazis...
A. F. : C’est pourtant vrai.
P. T. : A propos du juif charnel, je voudrais faire une distinction. Il y a la polémique dont on trouve l’écho dans les Evangiles : les disciples de Jésus reprochent à ceux des juifs, majoritaires, qui n’ont pas suivi leur maître, d’avoir été aveuglés par des images de grandeur. C’est une chose, mais c’en est une autre que de rapporter ensuite cette polémique à une essence du juif, qui serait définitivement " charnel ", alors que, par contraste, les chrétiens seraient " spirituels ". La conséquence est que l’accusateur se rend coupable de ce dont il accuse l’autre : au juif on reproche le goût de la puissance, mais cela alimente la volonté de puissance du chrétien. Si cela s’est produit, c’est que les juifs avaient été, dans l’esprit et au bénéfice des chrétiens, sortis, démis de l’histoire. La représentation que l’on avait d’eux s’est bloquée.
Est en cause ici la déformation qui a marqué la mission chrétienne, se glorifiant aux dépens de l’autre. Il est d’autant plus important d’y réfléchir que la situation présente est très différente. Les juifs, qui étaient en marge du monde, sont dans le monde puisqu’ils ont un Etat. Ils sont même au centre du monde en souvenir de la Shoah. A l’opposé, par la sécularisation, le christianisme européen apparaît dépossédé, démenti dans ses prétentions. Il nous faut donc apprendre à revenir sur notre histoire, afin de nous replacer autrement dans le monde, à nous replacer les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire à nous reconnaître à la fois charnels et spirituels, particuliers et universels.
Comment expliquer que l’antisémitisme continue d’obséder nos sociétés européennes ? Antisémitisme sans juifs, si on veut bien observer que la plus grande partie des juifs européens ont été exterminés ou ont émigré en Israël...
A. F. : On n’en aura jamais fini, en effet, avec l’antisémitisme... Et nous vivons aujourd’hui un poignant chassé-croisé des mémoires. A l’événement de la Shoah, qui prend une place toujours plus grande dans la conscience européenne, nos démocraties ont répondu par la religion de l’humanité, c’est-à-dire par l’universalisation de l’idée du semblable et la condamnation de tout ce qui divise ou sépare les hommes. " L’Europe est née à Auschwitz ", ont dit Bronislaw Geremek et Robert Badinter, lors de la commémoration du soixantième anniversaire de la libération des camps. Cela signifiait que, pour ne plus exclure qui que ce soit, l’Europe devait se défaire d’elle-même, se " désoriginer ", ne garder de son héritage que l’universalité des droits de l’homme. " Vacuité substantielle, tolérance radicale ", tel est, déclare le sociologue allemand Ulrich Beck, le secret de l’Europe. Nous ne sommes rien, c’est la condition préalable pour que nous ne soyons fermés à rien ni à personne.
Pour les juifs, il s’est passé tout autre chose. Ils n’ont pas emprunté la voie rédemptrice de l’indétermination. Ils ont découvert, avec l’hitlérisme, que, quoi qu’ils disent, fassent ou rêvent, ils étaient rivés à leur judéité. Ce que l’écrivain Aaron Appelfeld exprime admirablement et sans détour : " Vous étiez en marche vers les royaumes enchantés du rejet de soi quand, au beau milieu du chemin, vint la main satanique qui vous a ramené aux fondements de l’existence tribale et vous y maintint de force, non parce que vous étiez telle personne, que vous aviez telle opinion, mais parce que vous faisiez partie du peuple juif. " (dans L’Héritage nu, éd. de l’Olivier, 2006).
Hier encore complémentaires, la mémoire charnelle et la mémoire démocratique entrent aujourd’hui en conflit. La religion de l’humanité fait honte aux juifs de trahir les valeurs proclamées en leur nom. Et les voici à nouveau accusés, mais cette fois par un credo laïque, de s’obstiner dans l’ethnicisme. A l’heure du sans-frontiérisme et du " métissage " généralisé, l’Etat juif et l’identité juive apparaissent comme les très inquiétants vestiges du racisme séparateur. Tel est le paradoxe de notre situation : sous le choc de l’extermination, l’Eglise abandonne la réprobation du juif charnel et la démocratie la reprend fièrement à son compte.
P. T. : Je voudrais faire une lecture moins désespérante de la situation, même si je ne conteste pas l’essentiel de la description. Comment oublier que la conférence de Durban (Afrique du Sud) sur les droits de l’homme, en 2001, a vu une explosion d’anti-israélisme fanatique ? Je partirai, moi aussi, de la religion de l’humanité, mais en ajoutant qu’elle a connu plusieurs formes depuis la fin de la guerre et qu’elle pourrait en connaître d’autres. La première a été la religion " socialiste " de 1945, des travaillistes anglais jusqu’aux communistes. On allait vers une société de justice et d’égalité où la question juive s’évanouirait d’elle-même. Promesse d’assimilation et d’effacement, à la fois utopique, contestable et même perverse, puisque le stalinisme a pu s’en réclamer. Réponse au nazisme par-dessus la tête des juifs, sur lesquels régnait un " étrange silence ", comme l’écrivait Emmanuel Mounier - fondateur de la revue Esprit - , en 1945.
La deuxième forme de religion de l’humanité, l’actuelle, est la religion des droits de l’homme supposée offrir une réponse à ce retour de mémoire de la Shoah qui s’est produit à partir des années 1960. Elle est obsédée par le passé, comme désespérée de ne pas pouvoir faire que ce qui a eu lieu ne puisse pas être défait. Mais elle a abouti à un humanisme sans horizon qui se pose en juge de l’histoire et finit par s’en prendre au vouloir-vivre juif, en la " personne " d’Israël.
A. F. : Soyons clairs : la religion de l’humanité est la mienne. J’espère faire partie de ceux dont le sociologue français Emile Durkheim disait, au moment de l’affaire Dreyfus, que quiconque attente à la dignité d’un homme, quel qu’il soit, leur inspire un sentiment d’horreur analogue à celui du croyant quand il voit profaner son idole. Il reste que cette religion conduit ses apôtres les plus zélés à faire le procès du donné, de la particularité, de l’appartenance, bref de la chair et des juifs qui s’entêtent à lui demeurer fidèles.
On sait ou on devrait savoir ce qui s’est passé lors de la première conférence internationale de Durban contre le racisme, l’intolérance et la xénophobie. Mais sait-on qu’il se prépare un Durban 2, plus effrayant encore, avec un Conseil des droits de l’homme à Genève qui, dans l’indifférence générale, fait d’Israël un état génocidaire, et qui explique benoîtement que la laïcité européenne est en réalité discriminatoire et raciste ? Si la France ne frappe pas du poing sur la table, si les pays occidentaux ne menacent pas de boycotter cette conférence, l’Occident en général et l’Etat juif en particulier seront, plus encore qu’en 2001, les boucs émissaires des malheurs de l’Afrique et de la stagnation du monde arabo-musulman.
Nous devons tout faire pour éviter le " clash des civilisations ", mais une autre menace nous pend au nez : la rencontre des civilisations autour de la haine de tout ce qui porte le nom d’Israël. En guise de dialogue, on risque de voir l’antisémitisme antiraciste qui fleurit dans les démocraties du Nord entrer en résonance avec la vision paranoïaque du juif invisible et omnipotent qui sévit dans certains pays du Sud. Quand j’entends des experts français de la gauche qui se veut modérée affirmer que la baisse du taux de fécondité en Iran prouve que ce pays progresse vers la démocratie, que les menaces réitérées par son président négationniste d’effacer " l’entité sioniste " de la carte ne doivent pas être prises au sérieux et que le vrai danger actuel, c’est Israël, l’Amérique et la France américanisée, j’envisage avec effroi le grand rendez-vous civilisationnel de Durban 2.
P. T. : Je nuancerai. S’il y a un Durban 2, ce ne sera pas forcément la répétition de Durban 1. Les pays qui " émergent " du sous-développement peuvent adopter, à l’égard du judaïsme, une attitude totalement différente de celle du monde arabo-islamique, qui pourrait ne plus être le porte-parole du tiers-monde.
Reste la question : comment sortir de la religion du ressentiment qui a perverti la religion de l’humanité ? Ressentiment contre soi-même, contre son histoire d’abord. C’est la négativité de cette religion, sa fixation sur le mal qui est le Mal. Pour cette raison, je pense qu’elle a besoin d’un horizon moral et pratique correspondant à ce nouvel état de l’humanité qu’est la mondialisation, le mélange de marché et des droits de l’homme qui se propose pour cela étant à la fois irréaliste et insuffisant. Comment trouver de quoi aider et guider l’humanité sur la route du " perfectionnement de soi " ? Juifs et chrétiens, nous avons en commun une idée du bien à poursuivre qu’énonce la maxime qu’on associe à l’amour de Dieu et qui condense la loi dont Hitler a voulu assassiner le peuple messager : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même. "
On craint de s’égarer dans les nuées en se donnant une telle référence, mais, alors que se défont les cadres qui faisaient les moeurs, qui servaient de repère au sentiment d’obligation, l’humanité a besoin de faire un saut dans une moralité plus vaste. Ce serait aussi la bonne manière de répondre à Hitler. A ce propos, on a trop confondu le devoir de répliquer avec celui de dénoncer. D’où une surenchère qui a placé les juifs en position d’accusateurs universels. Le devoir actuel me paraît plutôt être de passer à une troisième forme de religion de l’humanité, où les juifs auraient une autre place que celle du reproche vivant.
Chez certains auteurs, on trouve une exhortation de plus en plus pressante à ce que les juifs et les chrétiens nouent une nouvelle alliance, en défense de " l’Occident " face à l’islamisme radical. Qu’en pensez-vous ?
A. F. : Je réponds à votre question par cette question : comment devons-nous répondre à ceux qui désignent notre civilisation comme leur ennemi ? Julien Freund, qui a introduit la pensée de Carl Schmitt en France, a eu cette phrase très profonde : " Ce n’est pas nous qui choisissons notre ennemi. C’est l’ennemi qui nous choisit. " Autrement dit, l’Histoire n’a pas, à proprement parler, de sujet. Nul n’en est l’auteur. Comme le souligne Hannah Arendt, elle n’est pas une oeuvre que l’on fait, mais un réseau d’actions et d’interactions immaîtrisable. Nous autres, Européens, nous sommes sortis de la seconde guerre mondiale persuadés que nos seuls ennemis étaient nos démons. Nous avons donc monté la garde, instauré le régime de la vigilance. Mais voici qu’un nouvel ennemi nous désigne : l’islamisme radical.
Devons-nous réagir ? Ceux qui s’y refusent, en tout cas, ne sont pas animés par l’esprit de paix, mais par une autre idée de la guerre : la guerre civile mondiale qui oppose les dominés aux dominants, c’est-à-dire à l’axe Washington - Tel-Aviv. La révolte des dominés, dans cette optique, est légitime, et ses formes les plus violentes toujours excusables. Eh bien non, l’Occident ce n’est pas seulement la domination, ce n’est pas seulement le crime, c’est un patrimoine, c’est un monde qui mérite d’être entretenu et perpétué. Il ne s’agit pas de revenir, après la fin ou la suspension des guerres idéologiques, aux guerres de religion et de mener, contre l’islam, je ne sais quelle croisade. L’agressivité de l’islamisme radical ne doit pas nous conduire à simplifier l’islam ni à le priver d’avenir en décrétant que les musulmans sont inaptes à la démocratie. Mais nous ne devons certainement pas répondre à la provocation par l’expiation.
P. T. : J’admets qu’on doive répliquer, mais de quelle manière ? En répondant mécaniquement à une hostilité par une autre ? Il se pourrait à ce propos que la référence hitlérienne nous égare, comme elle égare, d’une autre manière, les moralistes rivés au passé. Nos adversaires actuels sont-ils vraiment du type nazi ? Une " fermeté " qui n’est que ferme peut aboutir à des résultats ridicules, comme le prouve George Bush. Il nous faut appuyer notre fermeté sur une idée de ce dont l’humanité actuelle manque, prise entre le déchaînement du marché et la peur pour la planète : un horizon qui ne soit pas désespérant. Le judaïsme et le christianisme doivent être conscients de ce qui fait leur force possible : moins leur performance historique, dont le bilan sera toujours contesté, que ce qu’ils peuvent faire espérer, puisqu’ils sont les deux seules religions à se déterminer en fonction d’une fin, à voir l’humanité comme en chemin.
A. F. : Un chemin à proposer à l’humanité... sans doute. Encore faudrait-il que les juifs aient le loisir de penser à autre chose qu’à Israël. Cela devient difficile dès lors qu’une humanité de plus en plus judéocentrique se polarise sur ce pays, le regarde comme une erreur historique et rêve à haute voix de l’idylle que serait un monde où Israël n’existerait pas.
Mais si j’oublie un instant cette conjoncture douloureuse, je constate que ce qui caractérise les grands penseurs juifs du XXe siècle - Levinas, Arendt, Jonas -, c’est leur insistance sur le thème de la responsabilité. Répondre de l’Autre, répondre du monde, répondre de la culture et de l’expérience des belles choses et répondre de la terre : il ne s’agit plus de réaliser les grandes espérances, mais d’être ému et requis par la fragilité. Cette proposition d’humanité à l’humanité a du mal à se faire entendre, car ce qui règne aujourd’hui c’est le cynisme et le sentimentalisme associés. Les intellectuels, les artistes, les étudiants et les enfants ne cessent de faire la morale, et ils le font d’autant plus volontiers qu’ils n’ont à répondre de rien.
Je reviens sur la pénible affaire Guy Môquet : des professeurs ont dit qu’ils ne voulaient pas enseigner le patriotisme. Or, dans le monde d’aujourd’hui, on n’a que le mot " citoyenneté " à la bouche. On veut organiser des " débats citoyens ". On dit que l’enseignement du français doit nous apprendre à être de " bons citoyens ", ce qui est absurdement réducteur. L’idée de patrie et celle de la citoyenneté divorcent. Mais, comme le rappellent Aristote, Rousseau et plus récemment Arendt, " être citoyen veut dire, entre autres, que l’on a des responsabilités, des obligations et des droits : toutes choses qui ne prennent sens que si elles s’inscrivent dans un territoire ". Un citoyen désaffilié et déterritorialisé est voué à être à la fois ange et bête, c’est-à-dire à conjuguer la générosité la plus abstraite et l’égoïsme le plus étroit. Je ne sais pas s’il existe une pensée juive, mais des penseurs juifs peuvent nous aider, que nous soyons chrétiens, musulmans, juifs ou simples laïques, à sortir du messianisme politique par une autre voie : celle du principe de responsabilité.
P. T. : Je suis d’accord. Nous vivons dans une confusion du juridique et du moral. La morale désormais consiste à revendiquer des droits, elle se veut directement opposable à autrui, elle a quelque chose d’infantile, elle s’empare du droit pour s’éviter l’épreuve qui est pourtant la pierre de touche de la moralité, le fait de " prendre sur soi ", de se reconnaître responsable du monde. L’expérience morale, on la fait quand les choses vous atteignent, interrogent vos propres ressources éthiques. Tocqueville disait que le patriotisme est la première des vertus. Pas la plus haute, la première, celle qui déclenche toutes les autres, l’implication politique étant pour lui le moyen classique de faire échapper la morale à l’abstraction, pour qu’elle devienne exigence vécue et partagée.
Mais c’est dans des conditions de déréliction de la politique et d’infantilisme civique que les religions doivent reconsidérer leur rôle, non pour faire régner communautairement l’ordre moral dans leurs troupeaux, si jamais elles en sont capables, mais pour rendre capables ceux qu’elles touchent d’une véritable attitude morale. Elles peuvent en effet favoriser chez ceux qui entrent dans les récits dont elles sont porteuses la confiance dans le monde, l’espérance permise à une humanité qui va à tâtons vers ce qui la dépasse.
Cela incite réciproquement à réinterroger une laïcité dont la prétention à proposer une morale rationnelle se dissipe. Certes, la laïcité veut qu’on interpelle les religions et qu’on limite leur pouvoir en fonction de considérations civiques, mais la politique ne peut pas ignorer qu’elle aussi fait appel à ce qui en nous relève de la " foi " au sens premier, de cette confiance fondamentale qui a été notre premier contact avec la vie, dans laquelle nous sommes nés et que les grands récits religieux continuent de faire vivre en nous.
Propos recueillis par Jean Birnbaum et Henri Tincq
© Le Monde